Rockstar, habitué des open-world modernes, a réitéré l’expérience du jeu en monde ouvert en 2018 en proposant une aventure ensablée dans laquelle John Marston laisse sa place de fine gâchette à Arthur Morgan, le bras droit de Dutch Van Der Linde. Arthur, personnage principal de Red Dead Redemption II, est prêt à tout pour subvenir aux besoins de ce qu’il aime appeler « sa famille ». Mais entre deux missions, le cow-boy peut se balader au gré du vent dans une immense aire de jeu, poussant le joueur à ressentir cette curieuse et douce sensation de liberté qui émane régulièrement des productions Rockstar. Vous l’avez compris, aujourd’hui nous allons nous intéresser à la notion de liberté, chère aux papas de Grand Theft Auto.
![]()
GRAND-BANDITISME, SYNONYME DE LIBERTÉ
 Depuis toujours, les studios Rockstar ont pour mot d’ordre « grand-banditisme » et surtout « liberté ». Deux éléments que l’on retrouve dans pratiquement toutes leurs productions, qu’elles mettent en avant un jeu de course, un jeune lycéen envoyé en pensionnat, un gangster se baladant dans les rues de Los Angeles ou plus récemment un cow-boy en quête de rédemption. Les deux mots d’ordre ne peuvent d’ailleurs être dissociés l’un de l’autre. Le côté anarchique des jeux Rockstar est en vérité un prétexte pour mettre en avant le second terme, bien plus important : « liberté ». Ce mot permet à nous, joueurs, de réaliser toutes sortes d’actes possibles et inimaginables, souvent non recommandables. On peut alors laisser parler notre instinct plutôt que de suivre les règles dictées par notre société ou ceux d’un game-design trop restrictif, à l’inverse d’un Resident Evil par exemple, où le héros se retrouve cloisonné dans un manoir parsemé de zombies. De son côté, Rockstar décide d’intégrer des imprévus dans le déroulement de ses jeux. Pour donner un exemple parlant, revenons en 1997, année de sortie du premier open-world contemporain : Grand Theft Auto, premier opus d’une série qui marquera son temps, battra tous les records et donnera son nom à un genre, le GTA-like. Un type de jeu dans lequel s’engouffreront des titres comme Watch Dogs, Just Cause, Saints Row ou bien The Getaway. Des productions en monde ouvert qui permettent toutes sortes d’actes illégaux, tels que rouler à 300 kilomètres/heure sur l’autoroute, voler des véhicules ou les collectionner à l’image de ce que propose Driver : Parallel Lines.
Depuis toujours, les studios Rockstar ont pour mot d’ordre « grand-banditisme » et surtout « liberté ». Deux éléments que l’on retrouve dans pratiquement toutes leurs productions, qu’elles mettent en avant un jeu de course, un jeune lycéen envoyé en pensionnat, un gangster se baladant dans les rues de Los Angeles ou plus récemment un cow-boy en quête de rédemption. Les deux mots d’ordre ne peuvent d’ailleurs être dissociés l’un de l’autre. Le côté anarchique des jeux Rockstar est en vérité un prétexte pour mettre en avant le second terme, bien plus important : « liberté ». Ce mot permet à nous, joueurs, de réaliser toutes sortes d’actes possibles et inimaginables, souvent non recommandables. On peut alors laisser parler notre instinct plutôt que de suivre les règles dictées par notre société ou ceux d’un game-design trop restrictif, à l’inverse d’un Resident Evil par exemple, où le héros se retrouve cloisonné dans un manoir parsemé de zombies. De son côté, Rockstar décide d’intégrer des imprévus dans le déroulement de ses jeux. Pour donner un exemple parlant, revenons en 1997, année de sortie du premier open-world contemporain : Grand Theft Auto, premier opus d’une série qui marquera son temps, battra tous les records et donnera son nom à un genre, le GTA-like. Un type de jeu dans lequel s’engouffreront des titres comme Watch Dogs, Just Cause, Saints Row ou bien The Getaway. Des productions en monde ouvert qui permettent toutes sortes d’actes illégaux, tels que rouler à 300 kilomètres/heure sur l’autoroute, voler des véhicules ou les collectionner à l’image de ce que propose Driver : Parallel Lines.
Initialement prévu pour que le joueur incarne un citoyen modèle, Grand Theft Auto premier du nom se voit complètement remanié, car jugé pas assez fun par ses concepteurs. Le jeu est alors vu sous un angle bien différent. Cette fois-ci, le joueur n’incarne plus le good guy, mais un voyou tuant de sang-froid et travaillant pour les gros bonnets de la mafia avec tout ce que cela implique. Ce n’est maintenant plus au jeu de dicter ses règles, même s’il y en a encore, mais au joueur. Il peut aussi bien flâner en voiture que semer la zizanie pour le plaisir. Ce n’est donc pas un hasard si la ville de ce premier opus se nomme Liberty City. Un nom plein de promesses pour une cité inspirée de New York où les possibilités d’approches sont nombreuses.
![]()
Petite anecdote : La ville de Liberty City revient à trois reprises dans les épisodes principaux de la saga Grand Theft Auto, et à chaque fois, elle est là pour marquer l’arrivée d’une nouvelle génération de machines, et donc de nouvelles technologies. Ce détail n’a rien d’anodin puisque chaque « nouvelle technologie » est synonyme de puissance accrue et de possibilités nouvelles. Si GTA premier du nom sorti sur PlayStation propose un monde ouvert en vue du dessus, GTA 3, sorti en 2001 sur PlayStation 2, dévoile un univers tout en 3D. GTA IV, quant à lui, apporte en 2008, avec la septième génération de consoles, deux ingrédients supplémentaires pour faire de cette franchise un immanquable : un scénario doté d’une plume intelligente et une physique qui, aujourd’hui encore, reste exemplaire grâce au moteur Euphoria.
![]()
Ainsi, les années passent et la recette « GTA » s’étend et se décline chez les autres studios comme nous l’avons vu plus haut, mais également au sein même de l’entreprise qui va adapter sa formule miracle à d’autres genres. On citera notamment le monde de Midnight Club régi par les courses underground, un titre connu pour son absence de tracés véritables. Dans cette production, le joueur peut prendre n’importe quels chemins, routes ou ruelles de la ville, pour terminer sur la première marche du podium. Précisons que s’il était possible d’écraser les piétons au tout départ, cette idée sera finalement abandonnée avec Los Angeles, le quatrième opus de la série. Bien que Midnight Club ne soit qu’un « simple jeu de course », il permet tout de même de se balader entre deux missions en s’autorisant au passage quelques petites folies, contrairement aux autres productions similaires de l’époque.
![]()
CANIS CANEM EDIT, UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR ROCKSTAR
 Même si Rockstar a avant tout mis l’accent sur la sensation de liberté, le studio a toujours eu pour ambition de nous plonger dans le quotidien d’un personnage au destin peu ordinaire. De 1997 à 2002 le joueur incarne un malfrat en devenir, presque anonyme, qui souhaite monter les échelons du monde de la pègre, mais en 2004, le studio décide de mettre les petits plats dans les grands. Pour la première fois, Rockstar Games nous conte une véritable histoire ; pas n’importe laquelle, celle de CJ, pour Carl Johnson, un jeune afro-américain résidant dans les quartiers pauvres d’un Los Angeles fictif. En plus de libérer la parole sur des sujets controversés – ce qui donnera lieu à une nouvelle vague de titres traitant de la violence dans les banlieues (True Crime : New York City, Def Jam : Fight For NY, Crime Life, Gettin’ Up…) –, Grand Theft Auto : San Andreas immisce totalement le joueur dans la vie de son héros. CJ, ou plutôt la personne qui l’incarne, peut donc faire ce qui l’enchante comme se promener librement dans Grove Street, un quartier maintenant connu de toutes et tous, ou bien se rendre dans le bar du coin pour boire une bière, disputer une partie de billard ou se consacrer aux joies de l’arcade. CJ peut également faire de la compétition de low-rider, du BMX et du basket-ball, jouer la fashion-victim en achetant des t-shirts et autres sneakers, participer à des jeux d’argent ou tout simplement se ruer dans le premier fast-food du coin pour avaler quelques burgers bien gras. Mais pour ne pas aller à l’encontre du mot « liberté », et donc de ses fans, la production des frères Houser respecte entièrement le cahier des charges d’un « GTA ». Notre héros peut s’adonner à des activités plus fantasques comme dérober un train pour s’amuser à le faire dérailler, piloter un avion de chasse, voler un tank et faire face aux forces de l’ordre ou même contrôler un jet-pack. L’aspect bac-à-sable atteint ici son paroxysme. C’est simple, tout semble possible ou presque pour que le joueur ait enfin le sentiment d’être entièrement connecté à un univers virtuel. Même les missions scénarisées peuvent être parcourues selon notre bon vouloir. Faire un petit détour pour s’armer jusqu’aux dents ou voler un hélicoptère d’assaut est bien évidemment possible ; mieux, Grand Theft Auto : San Andreas nous pousse à le faire. La seule règle, s’il y en a une, est donc de survivre.
Même si Rockstar a avant tout mis l’accent sur la sensation de liberté, le studio a toujours eu pour ambition de nous plonger dans le quotidien d’un personnage au destin peu ordinaire. De 1997 à 2002 le joueur incarne un malfrat en devenir, presque anonyme, qui souhaite monter les échelons du monde de la pègre, mais en 2004, le studio décide de mettre les petits plats dans les grands. Pour la première fois, Rockstar Games nous conte une véritable histoire ; pas n’importe laquelle, celle de CJ, pour Carl Johnson, un jeune afro-américain résidant dans les quartiers pauvres d’un Los Angeles fictif. En plus de libérer la parole sur des sujets controversés – ce qui donnera lieu à une nouvelle vague de titres traitant de la violence dans les banlieues (True Crime : New York City, Def Jam : Fight For NY, Crime Life, Gettin’ Up…) –, Grand Theft Auto : San Andreas immisce totalement le joueur dans la vie de son héros. CJ, ou plutôt la personne qui l’incarne, peut donc faire ce qui l’enchante comme se promener librement dans Grove Street, un quartier maintenant connu de toutes et tous, ou bien se rendre dans le bar du coin pour boire une bière, disputer une partie de billard ou se consacrer aux joies de l’arcade. CJ peut également faire de la compétition de low-rider, du BMX et du basket-ball, jouer la fashion-victim en achetant des t-shirts et autres sneakers, participer à des jeux d’argent ou tout simplement se ruer dans le premier fast-food du coin pour avaler quelques burgers bien gras. Mais pour ne pas aller à l’encontre du mot « liberté », et donc de ses fans, la production des frères Houser respecte entièrement le cahier des charges d’un « GTA ». Notre héros peut s’adonner à des activités plus fantasques comme dérober un train pour s’amuser à le faire dérailler, piloter un avion de chasse, voler un tank et faire face aux forces de l’ordre ou même contrôler un jet-pack. L’aspect bac-à-sable atteint ici son paroxysme. C’est simple, tout semble possible ou presque pour que le joueur ait enfin le sentiment d’être entièrement connecté à un univers virtuel. Même les missions scénarisées peuvent être parcourues selon notre bon vouloir. Faire un petit détour pour s’armer jusqu’aux dents ou voler un hélicoptère d’assaut est bien évidemment possible ; mieux, Grand Theft Auto : San Andreas nous pousse à le faire. La seule règle, s’il y en a une, est donc de survivre.
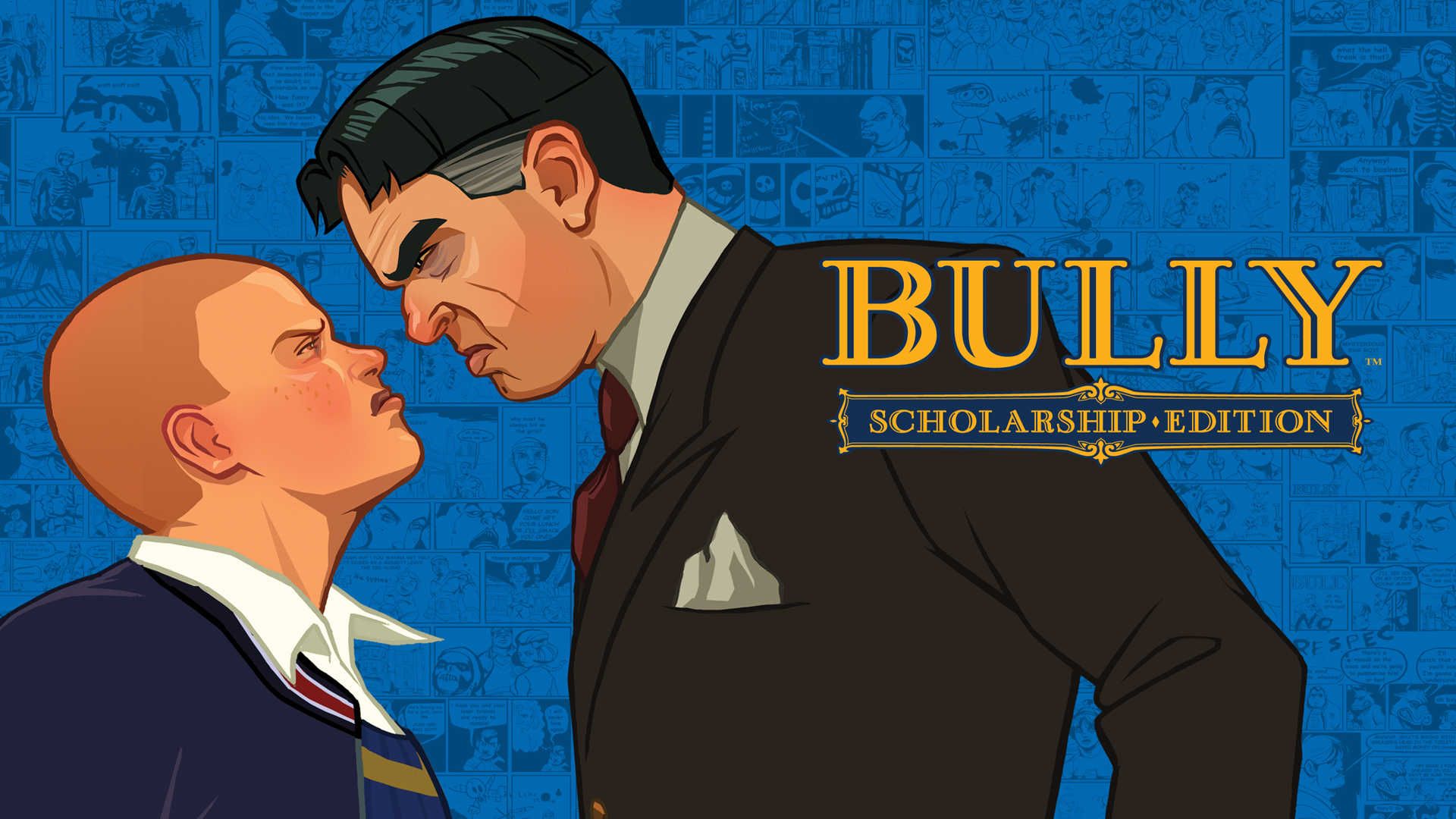 En 2006, c’est au tour d’une production mineure de Rockstar – et pourtant extrêmement importante pour la société – de faire son entrée sur PlayStation 2, à savoir Canis Canem Edit, que l’on retrouvera en 2008 sous son nom de code Bully sur PC, Xbox et Wii. Dans ce titre, le monde mis à la disposition du joueur change radicalement de ce qui était proposé auparavant. Ici, les gigantesques métropoles des GTA se transforment en un pensionnat où il est possible d’interagir avec n’importe quoi. Un lieu réfléchi faisant écho à notre personnage principal, un lycéen. Salles de classe, stade, dortoirs pour garçons comme pour filles, village avoisinant et fête foraine : voilà le nouveau terrain de jeu. Mais même si le titre met encore une fois l’accent sur la liberté, ce dernier s’éloigne tout de même de son modèle pour offrir une vision différente, celle du Rockstar d’aujourd’hui. Cette production, que je vois ici comme un exercice, permet à la société américaine d’affiner ses envies, de tenter de nouvelles approches, tout en prenant le moins de risques possible. La saga Grand Theft Auto compte désormais plus de 25 millions de fans et l’objectif ici, est de n’en décevoir aucun. Autrement dit, avec cette nouvelle franchise, Rockstar assume pleinement ce qu’il n’a pas osé entreprendre avec San Andreas : pousser le curseur « role-play » dans ses derniers retranchements.
En 2006, c’est au tour d’une production mineure de Rockstar – et pourtant extrêmement importante pour la société – de faire son entrée sur PlayStation 2, à savoir Canis Canem Edit, que l’on retrouvera en 2008 sous son nom de code Bully sur PC, Xbox et Wii. Dans ce titre, le monde mis à la disposition du joueur change radicalement de ce qui était proposé auparavant. Ici, les gigantesques métropoles des GTA se transforment en un pensionnat où il est possible d’interagir avec n’importe quoi. Un lieu réfléchi faisant écho à notre personnage principal, un lycéen. Salles de classe, stade, dortoirs pour garçons comme pour filles, village avoisinant et fête foraine : voilà le nouveau terrain de jeu. Mais même si le titre met encore une fois l’accent sur la liberté, ce dernier s’éloigne tout de même de son modèle pour offrir une vision différente, celle du Rockstar d’aujourd’hui. Cette production, que je vois ici comme un exercice, permet à la société américaine d’affiner ses envies, de tenter de nouvelles approches, tout en prenant le moins de risques possible. La saga Grand Theft Auto compte désormais plus de 25 millions de fans et l’objectif ici, est de n’en décevoir aucun. Autrement dit, avec cette nouvelle franchise, Rockstar assume pleinement ce qu’il n’a pas osé entreprendre avec San Andreas : pousser le curseur « role-play » dans ses derniers retranchements.
Pour moi, Bully marque un nouveau tournant pour le studio new-yorkais, si ce n’est le plus important (si on exclut GTA 3 et son monde en trois dimensions de l’équation). Le titre incarne tout simplement les prémices du western vidéoludique de 2018 qui, à ce jour, reste l’œuvre la plus ambitieuse et la plus sincère du studio. Mais n’allons pas trop vite et revenons sur le cas d’école Bully. Dans ce jeu, le joueur incarne le jeune Jimmy Hopkins, un enfant difficile qui mène la vie dure à sa mère et à son beau-père qui, malheureusement pour Jimmy, est plein aux as. Il envoie donc le jeune délinquant dans un établissement privé de la Nouvelle-Angleterre, la Bullworth Academy, où Jimmy devra vite faire parler les poings pour se faire respecter. Mais même si le scénario met la violence sur un piédestal en mettant en scène des querelles entre de nombreux groupes d’étudiants, rapidement, le joueur aura également la possibilité d’incarner un élève modèle. Se battre contre des blousons noirs, enfermer un sous-fifre dans un casier ou lui faire goûter l’eau des toilettes, ça va un temps… Le jeune Jimmy Hopkins est avant tout là pour étudier et ça, le jeu de Rockstar nous le rappelle constamment. Un planning avec des horaires de cours – qu’il est possible de suivre – est donc à disposition. Ces heures de math’, d’anglais, de sport ou de musique se présentent sous forme de mini-jeux éducatifs. Le héros a aussi le droit de se balader en ville pour faire quelques achats, monter sur une planche de skate, flirter avec des filles et des garçons, jouer à des jeux d’arcade, tondre la pelouse de la cour de l’école, participer à des courses de kart ou discuter avec l’ensemble de ses camarades. Ça ne vous rappelle rien ? Moi si… un certain Red Dead Redemption II. Avec Bully donc, tout est étudié (sans mauvais jeux de mots) pour que le joueur s’immerge complètement dans cette vie scolaire. Et contrairement à San Andreas qui n’hésite pas à proposer des activités dissonantes avec la vie de CJ, Bully ne va jamais à l’encontre des origines de Jimmy, qui reste un simple élève d’une quinzaine d’années. Il ne frappe pas les surveillants, n’affronte pas la police et ne vole pas des véhicules. Avec cette production, Rockstar assume le fait de vouloir raconter une histoire, de bâtir un univers cohérent et endosse pleinement son envie de proposer une dimension role-play. Toutefois, pour mettre en place cet aspect, il faut limiter les possibilités… détruire la dimension bac-à-sable. C’est donc à partir de 2006 que la vision de Rockstar du mot « liberté » est transformée.
![]()
AU SERVICE DE LA PLUME (ET DU CINÉMA)
 Si vous avez bien suivi toute l’histoire, nous sommes maintenant en 2008, date de lancement d’un des plus grands jeux de l’industrie : j’ai nommé l’incroyable Grand Theft Auto IV. Bon, je ne suis pas ici pour faire l’éloge de cette production qui aura marqué ma carrière de joueur (même si l’envie ne manque pas), mais pour démontrer pourquoi ce quatrième opus – qui, en réalité, est le sixième – a confirmé la nouvelle définition du mot « liberté » dans la bouche de Rockstar Games. Canis Canem Edit, même s’il s’est éloigné du carcan habituel, a été un véritable succès. La version PlayStation 2 du titre s’est vendue à plus d’1,5 million d’exemplaires à travers le monde. Et même si ce sont des chiffres loin d’être aussi impressionnants que ceux affichés par San Andreas, ce résultat a conforté la firme au R étoilé : les joueurs semblent fin prêts à recevoir une œuvre mature. L’entreprise a donc décidé d’aller plus loin, de mettre le sérieux et la cohérence de Bully au service d’un GTA. Résultat ? Un immense succès critique et commercial (GTA IV touche plus de 20 millions de personnes), et ce, même si de nombreux joueurs ont été déçus de ne pas retrouver les sensations d’antan. C’est d’ailleurs cette petite amertume qui a donné naissance à GTA V en 2013, un opus qui réalise un retour aux sources en prenant une fois de plus pour lieu d’action la ville de Los Angeles. Mais revenons à Grand Theft Auto IV…
Si vous avez bien suivi toute l’histoire, nous sommes maintenant en 2008, date de lancement d’un des plus grands jeux de l’industrie : j’ai nommé l’incroyable Grand Theft Auto IV. Bon, je ne suis pas ici pour faire l’éloge de cette production qui aura marqué ma carrière de joueur (même si l’envie ne manque pas), mais pour démontrer pourquoi ce quatrième opus – qui, en réalité, est le sixième – a confirmé la nouvelle définition du mot « liberté » dans la bouche de Rockstar Games. Canis Canem Edit, même s’il s’est éloigné du carcan habituel, a été un véritable succès. La version PlayStation 2 du titre s’est vendue à plus d’1,5 million d’exemplaires à travers le monde. Et même si ce sont des chiffres loin d’être aussi impressionnants que ceux affichés par San Andreas, ce résultat a conforté la firme au R étoilé : les joueurs semblent fin prêts à recevoir une œuvre mature. L’entreprise a donc décidé d’aller plus loin, de mettre le sérieux et la cohérence de Bully au service d’un GTA. Résultat ? Un immense succès critique et commercial (GTA IV touche plus de 20 millions de personnes), et ce, même si de nombreux joueurs ont été déçus de ne pas retrouver les sensations d’antan. C’est d’ailleurs cette petite amertume qui a donné naissance à GTA V en 2013, un opus qui réalise un retour aux sources en prenant une fois de plus pour lieu d’action la ville de Los Angeles. Mais revenons à Grand Theft Auto IV…
Comme nous l’avons vu en introduction, Grand Theft Auto IV nous emmène une fois de plus déambuler dans les rues de Liberty City. Sauf que cette ville fictive, qui s’inspirait autrefois de l’architecture de New York dans GTA et GTA 3, reprend cette fois-ci tous les traits de son modèle : Manhattan devient Algonquin ; Brooklyn, Broker ; Queens, Dukes ; le Bronx, Bohan et New Jersey, Alderney. Times Square est, de son côté, transformé en Star Junction et la Statue de la Liberté en Statue de l’Hilarité, en hommage à la sénatrice Hilary Clinton qui, souvenez-vous, avait pris pour cible à plusieurs reprises la saga Grand Theft Auto. Ce choix de cadre réaliste n’est bien évidemment pas le fruit du hasard, mais d’une décision consciencieuse de la part des développeurs. Ce New York « plus si fictif que cela » représente l’Amérique et tous les rêves qu’elle suscite. Notre héros, Niko Bellic, a grandi en Yougoslavie et a connu la guerre dès son plus jeune âge. Lorsque Roman, son cousin, l’appelle depuis Liberty City et lui fait part de sa réussite, Niko, aspirant à une vie meilleure, décide de le croire sur parole et de prendre le premier bateau venu pour atterrir sur cette terre dite prospère. Mais comme vous vous en doutez, le Rêve Américain n’est qu’une chimère, surtout pour un immigré. Rapidement donc, notre anti-héros va se rendre compte que Roman loge dans un appartement délabré au loyer trop cher et surtout, qu’il est obligé de pactiser avec la mafia locale pour pouvoir financer sa petite entreprise de taxi. Les hôtels de luxe, les grosses voitures et les filles de rêve, ce sera donc pour une autre vie…
San Andreas est déjà une œuvre politique majeure du jeu vidéo : elle prend pour toile de fond l’affaire Rodney King et les émeutes de Los Angeles de 1992, et comme je l’ai déjà précisé plus tôt, elle permet surtout de libérer la parole des banlieues dans le jeu vidéo. Mais maintenant que les premières barrières ont été franchies, la société new-yorkaise met les bouchées doubles. Avec GTA IV, elle s’attaque à des sujets actuels – les faits du jeu coïncident avec sa date de lancement, le 28 avril 2008 – et dénonce sans demi-mesure tous les méfaits de l’American Way of Life en mettant en tête d’affiche un immigré qui essaye de se faire une place dans un univers qu’il ne comprend pas vraiment. Pour ne pas dénaturer ce propos aussi triste que réaliste, les couleurs chatoyantes de Vice City (l’épisode de 2002) disparaissent pour laisser place à une ambiance monotone, étouffante et crade, qui fait écho aux buildings dénués de charme de la gigantesque métropole. L’esprit cartoon et les activités fantasques de San Andreas ont également disparu. Désormais, même si notre héros participe régulièrement à des tueries de masses (ce qui peut amoindrir la puissance du propos, je le conçois), Niko Bellic ne peut se munir d’un jet-pack ou utiliser des armes qui sortent de l’ordinaire. Mieux, le titre, à l’image de Canis Canem Edit, nous propose de nous mêler au quotidien de ce protagoniste. Au début de l’aventure, Niko prétend à une vie saine et rangée et fait tout pour y parvenir. Il met la main à la pâte pour faire tourner l’entreprise de son cousin, s’autorise à décompresser devant un verre ou en participant à un bowling et se rend même au cybercafé du coin pour prendre des nouvelles de sa mère restée au pays ou pour surfer sur des sites de rencontres. Même si toutes ces activités sont disponibles à n’importe quel moment de l’aventure, dans GTA IV, le prisme de la liberté, pourtant cher à la série, est mis au second plan pour, à l’image de Bully, mettre en avant la cohérence d’un récit. Un récit mature, violent et sérieux qui n’hésite pas à renforcer ses propos en s’inspirant du septième art et plus précisément du cinéma de Guy Ritchie (Arnaques, Crimes et Botanique, Snatch), de Martin Scorsese (Taxi Driver), de Michael Mann (Heat), de Spike Lee (La 25e Heure) et de James Gray (La nuit nous appartient).
Toutefois, malgré le succès critique de GTA IV, le jeu vidéo est encore vu comme un art mineur par les médias et la politique. Pour changer cela, Rockstar affine sa plume et transforme peu à peu le joueur en un acteur studio et ses jeux en de gigantesques plateaux de tournage. Cette nouvelle proposition aux ambitions cinématographiques s’impose peu à peu dans les différentes productions Rockstar. En 2010, elle s’attaque à Red Dead Redemption qui met en scène la fin d’un monde sauvage. En 2013, elle s’immisce dans Grand Theft Auto V et son histoire hollywoodienne blindée de clins d’œil. Et en 2018, elle s’empare totalement de Red Dead Redemption II, une production qui, avant même son annonce, avait enflammé le net grâce à un simple changement de bannière Twitter. Une communication sobre, mais terriblement efficace.
![]()
QUAND LA LIBERTÉ LAISSE PLACE À LA NARRATION
 Avec Red Dead Redemption II, Rockstar concocte un rêve éveillé pour tous les amateurs de western. Il propose aux joueurs de s’immerger complètement dans un far-west virtuel en permettant de se comporter comme un hors-la-loi, un vrai, de la fin des années 1800. Chasser, braquer une banque, galoper à bride abattue avec sa bande, réaliser un feu de camp, brosser son cheval, pêcher, aider son prochain ou bien le mettre en joue… la production apparaît tout simplement comme la simulation de cow-boy ultime. La dimension role-play importée par Bully en 2006 prend désormais tout son sens. Les références cinématographiques sont, quant à elles, décuplées afin d’élaborer un scénario à la hauteur des inspirations. Malgré quelques maladresses d’écriture ici et là (l’histoire traîne en longueur), Red Dead Redemption II conte intelligemment les aventures de tout un gang qui n’arrive plus à trouver sa place dans cette Amérique devenue industrielle. Dès les premières heures de jeu, que ce soit Arthur Morgan, le personnage principal de cet épisode, Hosea Matthews, Sadie Adler ou encore Charles Smith, tous se montrent attachants. Même les protagonistes les plus détestables et les plus anecdotiques de cette épopée le sont. Par exemple, je n’ai cessé de vouloir passer du temps avec ce bon vieux Hamish ou bien avec la veuve Charlotte, deux personnages secondaires que l’on rencontre qu’à de (trop) rares moments. Toutefois, et c’est là la raison principale de cet article, toutes ces qualités ont malheureusement un prix : celui de la liberté.
Avec Red Dead Redemption II, Rockstar concocte un rêve éveillé pour tous les amateurs de western. Il propose aux joueurs de s’immerger complètement dans un far-west virtuel en permettant de se comporter comme un hors-la-loi, un vrai, de la fin des années 1800. Chasser, braquer une banque, galoper à bride abattue avec sa bande, réaliser un feu de camp, brosser son cheval, pêcher, aider son prochain ou bien le mettre en joue… la production apparaît tout simplement comme la simulation de cow-boy ultime. La dimension role-play importée par Bully en 2006 prend désormais tout son sens. Les références cinématographiques sont, quant à elles, décuplées afin d’élaborer un scénario à la hauteur des inspirations. Malgré quelques maladresses d’écriture ici et là (l’histoire traîne en longueur), Red Dead Redemption II conte intelligemment les aventures de tout un gang qui n’arrive plus à trouver sa place dans cette Amérique devenue industrielle. Dès les premières heures de jeu, que ce soit Arthur Morgan, le personnage principal de cet épisode, Hosea Matthews, Sadie Adler ou encore Charles Smith, tous se montrent attachants. Même les protagonistes les plus détestables et les plus anecdotiques de cette épopée le sont. Par exemple, je n’ai cessé de vouloir passer du temps avec ce bon vieux Hamish ou bien avec la veuve Charlotte, deux personnages secondaires que l’on rencontre qu’à de (trop) rares moments. Toutefois, et c’est là la raison principale de cet article, toutes ces qualités ont malheureusement un prix : celui de la liberté.
Il a suffi de quelques jours après le lancement du jeu pour que les joueurs fassent part de leurs frustrations sur internet. La plupart pointait notamment du doigt des contrôles peu ergonomiques, d’autres les déplacements patauds d’Arthur et d’autres encore l’aspect trop contemplatif du jeu… Mais le vrai problème de Red Dead Redemption II réside ailleurs. Cette déception globale est générée par un tout autre facteur : celui de ne pas se sentir pleinement libre dans ce gigantesque monde, d’avoir l’impression d’être constamment pris par la main par les développeurs. Rockstar Games fait en effet le choix de chambouler les habitudes des fans en allant à l’encontre de ce que la maison a toujours proposé. Les open-world des productions du studio, autrefois entièrement dévolus à notre bon plaisir, deviennent avec Red Dead Redemption II de gigantesques faire-valoir servant principalement la narration (une vision plus ou moins présente dans Bully, GTA IV et le premier Red Dead Redemption). Ainsi, New Austin est une terre infranchissable avant la fin du jeu, les armes à feu sont interdites dans la ville de Rhodes ou dans la réserve indienne et il est impossible de sortir de la zone d’introduction sans être contraint de faire demi-tour. Arthur nage peu de temps dans les eaux profondes également et se déplace lentement dans de nombreux endroits, à commencer par son campement où la course et l’accès à dos de cheval sont interdits. Vous l’avez compris, au fur et à mesure que l’on suit les périples d’Arthur Morgan, on se rend compte que les lieux ne sont qu’un prétexte pour raconter une histoire. Pas la nôtre, mais celle écrite à l’avance par les scénaristes. Certes, cette aventure est bien contée, mais elle ne cesse de nous couper dans notre élan de joueur souhaitant apprivoiser ce tout nouveau terrain de jeu.
Même constat pour les différents outils mis à notre disposition. Contrairement aux œuvres passées du studio, dans Red Dead Redemption II, ces éléments ne sont plus là pour amuser le joueur et le laisser improviser avec, mais pour l’obliger à s’en servir à un moment clef. L’objectif ici est de montrer toutes les facettes du jeu qui, on le rappelle, a eu le droit à plus de huit années de développement. Pour nous forcer à savourer « à la manière de », le titre peut, par exemple, prendre le contrôle de notre cheval et nous pousser à prendre un chemin plutôt qu’un autre, nous obliger à nous munir d’un manteau chaud pour grimper dans les montagnes sous peine de voir la vie d’Arthur se consommer à petit feu ou nous empêcher d’agir lors des événements aléatoires. Même si j’ai eu la chance de pouvoir interagir avec l’un d’eux – j’ai notamment dissous un groupe de Ku Klux Klan à coup de dynamites lors de ma première session de jeu (ce qui était fort plaisant) –, j’ai eu la fâcheuse surprise d’être dans l’impossibilité d’intervenir lors de cette même séquence en débutant une nouvelle partie. De joueur, je suis devenu un simple acteur studio exécutant les règles dictées par Rockstar Games. Eh oui, si l’on approche trop ces hommes sans foi ni loi, il est tout simplement impossible de dégainer son arme à feu ou même de détourner le regard. Il ne nous reste alors qu’à contempler cette petite histoire, certes amusante – l’un des membres de ce groupe d’extrémistes prend feu et embrase tous ses camarades malgré lui – mais surtout frustrante.
Ce manque de liberté gangrène également les missions scénarisées puisque dans celles-ci, nous sommes dans l’obligation de suivre nos compagnons à dos de cheval pour atteindre l’objectif fixé. L’open-world est alors transformé en un gigantesque couloir servant, une fois de plus, exclusivement la narration. En plus d’être servi avec une visée automatisée (je vous conseille de désactiver l’assistance), les gunfights, en mission, sont aussi extrêmement scriptés. Ils nous imposent une façon de procéder, celle qui a été rédigée en amont par l’un des frères Houser. Si le jeu en a décidé autrement, n’espérez pas contourner un gang pour le surprendre, tuer un ennemi avec une arme à feu alors qu’il fallait l’étrangler discrètement ou vous amuser à repousser des hordes de brigands le plus longtemps possible.
Pour tout vous dire, dès le début de l’aventure, soit durant l’objectif « De vieux amis », le titre empêche le joueur de progresser comme bon lui semble. Dans cette mission, lorsqu’Arthur doit descendre une pente enneigée au côté de Dutch, il est impossible de dévier sur la gauche ou la droite. Il suffit alors de pousser simplement le joystick gauche de la manette vers l’avant pour que notre cow-boy suive les pas de son acolyte. Cette preuve supplémentaire démontre une fois de plus qu’avec cette production, Rockstar impose tout : le rythme pour parcourir leur monde et le rythme pour parcourir leur histoire, ce qui va à l’encontre même de leurs premiers jeux. La partie liberté, qui était une donnée essentielle des premières productions de la firme, est alors effacée. Quand un Grand Theft Auto IV pouvait être facilement terminé en moins de dix heures, Red Dead Redemption II, lui, nous demande obligatoirement une quarantaine d’heures pour en venir à bout puisqu’il est impossible de sortir des sentiers battus.
![]()
UN MODE ONLINE POUR NOUS RASSEMBLER TOUS
Même si ces propos sur Red Dead Redemption II peuvent paraître durs, je trouve le titre absolument fascinant (et c’est d’ailleurs ce qui m’a poussé à écrire une première version de cette analyse fin 2018 sur PADologie, puis une seconde sur JV en 2019 et cette dernière bien plus complète début 2022). En plus de proposer des personnages hauts en couleur comme nous l’avons vu plus tôt, le western vidéoludique décrit avec brio un monde sauvage en perdition. Cet univers, au sens du détail démesuré, transpire la poussière, dévoile des séquences dantesques et comporte même des graphismes à couper le souffle qui, aujourd’hui encore, explose la concurrence. En dehors des missions, les scènes d’action sont absolument sublimes. Elles mettent en avant une violence crue, reflet de cette époque, en mettant à disposition des joueurs de nombreux moyens pour prendre d’assaut un camp ennemi : approche furtive, système de combat au corps-à-corps complet, arsenal varié et option Sang-froid qui permet de ralentir le temps et de gagner en précision. Les réactions des ennemis sont, quant à elles, extrêmement crédibles. Les visages se déforment sous le poids de nos phalanges et la colère comme la souffrance se lisent dans leurs yeux. Autrement dit, les séquences s’enchaînent, mais ne se ressemblent jamais.
Mais finalement, ce qui m’a fait adorer Red Dead Redemption II, c’est avant tout son mode Online. Même s’il n’a pas reçu un très bon accueil de la part du public – la faute à un manque d’ajouts de contenus sur le long terme –, cette facette du jeu résume parfaitement la carrière de Rockstar Games. Pour moi, la dimension Online de Red Dead Redemption II concilie tout ce qui fait la force des jeux de la maison américaine. Il allie l’aspect role-play des dernières productions et l’esprit bac-à-sable initié par les premiers jeux. En plus de permettre aux joueurs de réaliser tout ce qui est possible dans le Solo, ce mode, que l’on peut aussi bien parcourir en solitaire comme en groupe, ajoute également de nouvelles animations, des armes inédites et même des métiers. Il est par exemple possible de se transformer en marchand ou de s’occuper de son propre bar/distillerie, ce qui ajoute des possibilités supplémentaires. Mais ce qu’il fait de mieux, c’est qu’il laisse le joueur agir comme bon lui semble. L’histoire prend ici moins de place, ce qui permet aux développeurs de lâcher du lest. En d’autres termes : de nous laisser jouer.
Depuis ses débuts à la fin des années ’90, Rockstar a réalisé une véritable ascension. De petit studio presque transparent, ignoré par la presse, la maison des frères Houser est devenue l’une des plus importantes du monde vidéoludique. Cet exploit, on le doit à GTA 3 qui est venu chambouler l’industrie, puis à San Andreas qui s’est rapidement imposé comme le plus grand bac-à-sable moderne de tous les temps. Au fur et à mesure de cette montée en puissance, la firme a réajusté sa vision du jeu et notamment sa conception du mot « liberté ». Ce principe, qui laissait autrefois libre cours à l’imagination des joueurs, s’est agrémenté de plusieurs règles avec le temps. Canis Canem Edit, afin de conférer plus de cohérence à son univers, a développé une dimension role-play et GTA IV est arrivé avec une perception plus cinématographique. Red Dead Redemption II, lui, fait le choix de s’emparer du septième art pour offrir au jeu vidéo un western à la hauteur des films dont il s’inspire. Peut-être un peu trop, puisque les développeurs ont ici la main mise sur le joueur qui se voit limité dans tout ce qu’il entreprend (tout du moins dans la partie Solo). Aujourd’hui, même si j’en attends beaucoup moins de la part de Rockstar, j’aimerais que le studio prenne exemple sur les trois dernières œuvres que je viens de citer afin d’ajuster avec finesses les trois curseurs qui guident maintenant les créations du studio américain : « liberté », « cohérence » et « scénarisation ». Il ne reste plus qu’à espérer que la société arrive à ce résultat dans les années à venir. Pourquoi pas avec un certain GTA VI qui fait déjà (inutilement) beaucoup parler de lui alors qu’il n’a jamais été annoncé officiellement.























