2024 a été une année charnière pour moi. C’est durant celle-ci que je me suis plongé corps et âme dans mon premier livre, le hors-série Rockstar pour Jeux Vidéo Magazine, le premier numéro d’une toute nouvelle collection. Cette opportunité m’a ouvert des portes : elle m’a amené à écrire au sein du collectif PlayStation 30e Anniversaire d’Omaké et à entamer des projets colossaux qui verront le jour prochainement. Ce train de vie a évidemment redéfini ma façon même de m’immerger dans un jeu vidéo : mon temps étant plus compté que jamais, je sélectionne davantage mes jeux, et en contrepartie passe plus d’heures sur ceux que j’apprécie vraiment, là où autrefois, j’avais tendance à papillonner. Cette nouvelle dynamique impose une liste 2025 plus courte qu’à l’accoutumée. Vous êtes prévenu·es !
![]()
Barème :
☆☆☆☆☆ : Exécrable
★☆☆☆☆ : Insignifiant
★★☆☆☆ : Divertissant
★★★☆☆ : Bon
★★★★☆ : Excellent
★★★★★ : Chef-d’œuvre
![]()
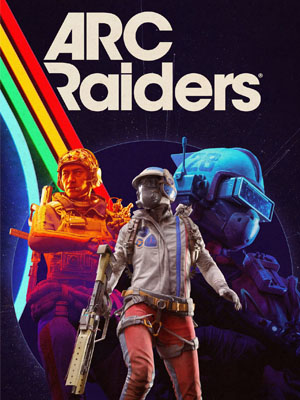 Des balles fusent, d’autres claquent, résonnent, pendant que notre raider, apeuré·e, longe les murs, tente de se faire oublier. Ses semblables malintentionné·es le cherchent, tout comme les redoutables machines sillonnant les cieux. En plus de rendre accessible un genre autrefois de niche, l’extraction shooter, ARC Raiders est livré avec une ambiance absolument irréprochable, poussée par des éclairages magnifiques – indiquant ici et là la présence d’un danger –, et un sound-design exemplaire, parfaitement localisé dans l’espace. Tout comme les lumières, chaque explosion, détonation ou moindre bruit de tôle, est un mystérieux avertissement que la curiosité entraîne à élucider ou la peur au ventre, à fuir. La force d’ARC Raiders est surtout qu’il favorise les interactions sociales entre participant·es. Un·e survivant·e au loin peut donc incarner une menace comme un·e futur·e allié·e avec qui il est possible de détrousser les plus grosses machines, parfois aussi grandes qu’un building. Ses matériaux doivent être ramenés au cœur de Speranza, ville souterraine et dernier bastion de l’humanité.
Des balles fusent, d’autres claquent, résonnent, pendant que notre raider, apeuré·e, longe les murs, tente de se faire oublier. Ses semblables malintentionné·es le cherchent, tout comme les redoutables machines sillonnant les cieux. En plus de rendre accessible un genre autrefois de niche, l’extraction shooter, ARC Raiders est livré avec une ambiance absolument irréprochable, poussée par des éclairages magnifiques – indiquant ici et là la présence d’un danger –, et un sound-design exemplaire, parfaitement localisé dans l’espace. Tout comme les lumières, chaque explosion, détonation ou moindre bruit de tôle, est un mystérieux avertissement que la curiosité entraîne à élucider ou la peur au ventre, à fuir. La force d’ARC Raiders est surtout qu’il favorise les interactions sociales entre participant·es. Un·e survivant·e au loin peut donc incarner une menace comme un·e futur·e allié·e avec qui il est possible de détrousser les plus grosses machines, parfois aussi grandes qu’un building. Ses matériaux doivent être ramenés au cœur de Speranza, ville souterraine et dernier bastion de l’humanité.
Mais si ARC Raiders prône l’entraide entre joueurs et joueuses afin de surmonter les nombreux défis de la surface, la quête de ressources est étrangement égoïste : elle a pour dessein d’améliorer uniquement son propre équipement, celui qui sert à mener des raids en extérieur. Mais n’étant pas un jeu compétitif, montrer sa supériorité à coup de flingues et de statistiques ne peut être une fin en soi. Pour que l’univers d’ARC Raiders gagne en consistance, une approche plus survivaliste et communautaire aurait été nécessaire. À la manière d’un This War of Mine par exemple, notre raider pourrait être dans l’obligation de récupérer de la nourriture et des matériaux une fois à la surface afin d’améliorer la qualité de vie de Speranza. Ce type d’objectif – adopté par le passé de manière schématique par le mode multijoueur de The Last of Us – offre une vision plus large de la situation et aurait par ailleurs pu prévenir d’un problème plus conséquent.
Dans ARC Raiders, les ressources sont en abondances. Arsenal gratuit, poches secrètes, coq… toutes les options d’accessibilités vont d’ailleurs dans ce sens : elles permettent d’avoir toujours le minimum requis de composants pour repartir, même après une défaite, armé·e jusqu’aux dents. Et étant donné que ces mêmes ressources ne servent pas de causes plus grandes que celle d’améliorer son propre personnage, elles ne sont jamais essentielles. Autrement dit, le loot, formant ici l’économie du titre, devient vite une activité secondaire. Les joueurs et les joueuses s’en sont rendus compte, ce qui a donné vie à de nouvelles formes de jeu. Moins d’un mois après la sortie du soft, les raiders n’ont plus peur de rien et foncent à travers les cartes pour trouver leur prochaine victime, qu’elle soit machine ou humaine. En effet, si un brise-fuselage (équivalent d’un lance-grenades) peut s’échanger contre trois cents graines produites par notre coq domestique, à quoi bon s’inquiéter de le perdre au combat ? Pour que ARC Raiders ait à nouveau du sens, il faut revoir la rareté des objets ou instaurer, comme écrit plus haut, une cause plus grande : mettre la survie de Speranza en jeu. Les différents événements saisonniers tentent de parer cette faille, mais cela introduit inévitablement des périodes de flottement, tandis que le discours général s’en trouve malheureusement vidé. Le jeu, manette en mains, est incroyable, mais en quoi consistent réellement les raids ? ♦ Retrouver la critique sur Jeux Vidéo Magazine
ARC RAIDERS (2025)
★★★★☆
![]()
 L’existence de ce jeu, en tant que tel – une extension cachée derrière une production qui n’a finalement pas grand-chose à voir –, est une hérésie. Bowser’s Fury mériterait d’être sur le devant de la scène, d’incarner un épisode à part entière, tant il se montre bien plus malin que sa source, Super Mario 3D World. Mieux, alors qu’il prend la forme d’un sujet d’expérimentation, il peaufine finalement la formule d’Odyssey, qui avait confondue générosité avec remplissage. En se limitant à un seul monde, contre dix-sept pour Odyssey, l’expérience s’en trouve améliorée : le soft se veut plus ramassé – exit les 666 lunes à récolter – tout en parvenant à conserver ce qui faisait la force de son aîné, ces récompenses régulières créant de la dopamine. L’univers se montre également plus cohérent, plus crédible : il évolue en temps réel sous nos yeux – une prouesse. Les décors paradisiaques de Bowser’s Fury se teintent de méchanceté au fur et à mesure que la colère de l’ennemi juré de Mario monte. Cette dernière, dans une explosion, finit par plonger l’ensemble dans les ténèbres. C’est d’ailleurs la preuve qu’il n’y a pas besoin de SSD magique pour passer d’une ambiance à une autre en un claquement de doigts. Un petit coup de cœur !
L’existence de ce jeu, en tant que tel – une extension cachée derrière une production qui n’a finalement pas grand-chose à voir –, est une hérésie. Bowser’s Fury mériterait d’être sur le devant de la scène, d’incarner un épisode à part entière, tant il se montre bien plus malin que sa source, Super Mario 3D World. Mieux, alors qu’il prend la forme d’un sujet d’expérimentation, il peaufine finalement la formule d’Odyssey, qui avait confondue générosité avec remplissage. En se limitant à un seul monde, contre dix-sept pour Odyssey, l’expérience s’en trouve améliorée : le soft se veut plus ramassé – exit les 666 lunes à récolter – tout en parvenant à conserver ce qui faisait la force de son aîné, ces récompenses régulières créant de la dopamine. L’univers se montre également plus cohérent, plus crédible : il évolue en temps réel sous nos yeux – une prouesse. Les décors paradisiaques de Bowser’s Fury se teintent de méchanceté au fur et à mesure que la colère de l’ennemi juré de Mario monte. Cette dernière, dans une explosion, finit par plonger l’ensemble dans les ténèbres. C’est d’ailleurs la preuve qu’il n’y a pas besoin de SSD magique pour passer d’une ambiance à une autre en un claquement de doigts. Un petit coup de cœur !
BOWSER’S FURY (2021)
★★★★☆
![]()
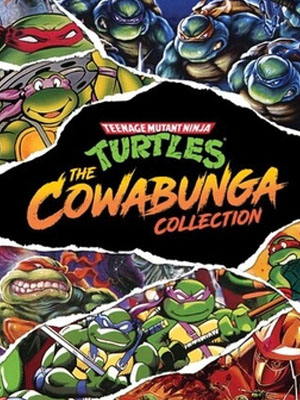 Si refaire les jeux aujourd’hui est dispensable, surtout que beaucoup sont des copiés-collés des uns et des autres, la Cowabunga Collection s’inscrit comme une véritable pièce de musée. Elle est un voyage temporel, accompagnée de mini-making-of (notices, esquisses, covers…), qui retrace les premiers pas vidéoludiques de la franchise TMNT, jusqu’à la révélation de 1992. Oui, la Cowabunga Collection est surtout l’occasion d’illustrer noir sur blanc la raison du succès de Turtles in Time, véritable révolution qui ramène avec brio sur consoles l’expérience et la finition offertes par les beat’em up destinés aux bornes d’arcade : encore aujourd’hui, par le soin apporté aux animations, aux couleurs, les tortues et leurs ennemis évoluant sur l’écran semblent directement provenir de la série de 1987. Devenu par la suite pierre angulaire de la licence, le titre sert toujours de modèle aux nouveaux venus : Shredder’s Revenge, véritable hommage – auquel je reproche d’ailleurs d’être un peu trop dans l’imitation –, en est la parfaite illustration. Bien que complète et réussie, la Cowabunga Collection est uniquement à conseiller aux adeptes de la licence qui, pad en mains, souhaiteraient voir l’évolution tonitruante des tortues !
Si refaire les jeux aujourd’hui est dispensable, surtout que beaucoup sont des copiés-collés des uns et des autres, la Cowabunga Collection s’inscrit comme une véritable pièce de musée. Elle est un voyage temporel, accompagnée de mini-making-of (notices, esquisses, covers…), qui retrace les premiers pas vidéoludiques de la franchise TMNT, jusqu’à la révélation de 1992. Oui, la Cowabunga Collection est surtout l’occasion d’illustrer noir sur blanc la raison du succès de Turtles in Time, véritable révolution qui ramène avec brio sur consoles l’expérience et la finition offertes par les beat’em up destinés aux bornes d’arcade : encore aujourd’hui, par le soin apporté aux animations, aux couleurs, les tortues et leurs ennemis évoluant sur l’écran semblent directement provenir de la série de 1987. Devenu par la suite pierre angulaire de la licence, le titre sert toujours de modèle aux nouveaux venus : Shredder’s Revenge, véritable hommage – auquel je reproche d’ailleurs d’être un peu trop dans l’imitation –, en est la parfaite illustration. Bien que complète et réussie, la Cowabunga Collection est uniquement à conseiller aux adeptes de la licence qui, pad en mains, souhaiteraient voir l’évolution tonitruante des tortues !
TMNT : COWABUNGA COLLECTION (2022)
★★★☆☆
![]()
 Des lunes colorées en guise d’encas, une grenouille propriétaire d’un café, une lapine comme meilleure amie et un skateur fait de verre parcourant des routes stellaires. Skate Story nous plonge dans un songe, enivrant, dans lequel on se plaît à rider des heures durant. Aveu de son créateur, Sam Eng, le titre se présente comme la métaphore de déambulations nocturnes – casque audio sur les oreilles et planche à roulettes sous les pieds – où tout ce que l’on voit est soumis à la rêverie, déformé par les lueurs blafardes des lampadaires de la ville, des phares dansants des automobiles. Pour matérialiser ce rêve étrange, les environnements sont des peintures acidulées, vaporeuses, où notre héros de verre endosse le rôle de réceptacle : ses faces transparentes, par de jolies réflexions de lumières, absorbent les différents terrains de jeu – une manière pour le personnage de se les approprier aussi bien par le geste, comme le ferait tout bon skateur ou skateuse qui se respecte, que par l’image.
Des lunes colorées en guise d’encas, une grenouille propriétaire d’un café, une lapine comme meilleure amie et un skateur fait de verre parcourant des routes stellaires. Skate Story nous plonge dans un songe, enivrant, dans lequel on se plaît à rider des heures durant. Aveu de son créateur, Sam Eng, le titre se présente comme la métaphore de déambulations nocturnes – casque audio sur les oreilles et planche à roulettes sous les pieds – où tout ce que l’on voit est soumis à la rêverie, déformé par les lueurs blafardes des lampadaires de la ville, des phares dansants des automobiles. Pour matérialiser ce rêve étrange, les environnements sont des peintures acidulées, vaporeuses, où notre héros de verre endosse le rôle de réceptacle : ses faces transparentes, par de jolies réflexions de lumières, absorbent les différents terrains de jeu – une manière pour le personnage de se les approprier aussi bien par le geste, comme le ferait tout bon skateur ou skateuse qui se respecte, que par l’image.
Skate Story n’est pas que poésie, il est aussi un jeu de skate qui, à l’inverse de ses congénères priorisant la performance, met en valeur la beauté du geste. Si la prise en main peut s’avérer délicate, tant elle s’éloigne de ce à quoi nous sommes habitués, une fois que l’on comprend que le dessus de la manette symbolise la planche vue du ciel, les figures s’enchaînent et laissent place à des élans cinématographiques rappelant les premiers pas de la saga Skate. Ainsi, la caméra n’est pas seulement un outil au service de la compréhension de l’espace, mais se transforme en un objectif que l’on se plaît à cadrer, pour mettre en valeur les envolées de notre personnage, parfaitement animé et régulièrement cerné par de magnifiques ralentis. ♦ Retrouver la critique sur Jeux Vidéo Magazine
SKATE STORY (2025)
★★★★☆
![]()
 Outre sa plastique rendant parfaitement compte d’un monde entièrement fait de briques, LEGO Horizon Adventures manque grandement de folie. Le jeu semble captif d’un cahier des charges, et finit – peut-être sans le vouloir – par se contenter du minimum. Si la base est bonne et qu’elle aurait pu donner un bon jeu, tous les niveaux du soft sont construits exactement de la même manière. Ces derniers recyclent continuellement de mêmes assets et font vivre encore et encore les mêmes péripéties : en ouverture, une emphase est mise sur la contemplation ; à la mi-parcours, un marchand ambulant, toujours situé dans un même décor, propose deux objets aux joueurs et aux joueuses ; pour finir, des machines attendent d’être vaincues dans une minuscule arène. Et là où le jeu d’origine dévoile deux approches dans ce genre de situation, action ou infiltration, LEGO Horizon Adventures ne permet que de foncer dans le tas.
Outre sa plastique rendant parfaitement compte d’un monde entièrement fait de briques, LEGO Horizon Adventures manque grandement de folie. Le jeu semble captif d’un cahier des charges, et finit – peut-être sans le vouloir – par se contenter du minimum. Si la base est bonne et qu’elle aurait pu donner un bon jeu, tous les niveaux du soft sont construits exactement de la même manière. Ces derniers recyclent continuellement de mêmes assets et font vivre encore et encore les mêmes péripéties : en ouverture, une emphase est mise sur la contemplation ; à la mi-parcours, un marchand ambulant, toujours situé dans un même décor, propose deux objets aux joueurs et aux joueuses ; pour finir, des machines attendent d’être vaincues dans une minuscule arène. Et là où le jeu d’origine dévoile deux approches dans ce genre de situation, action ou infiltration, LEGO Horizon Adventures ne permet que de foncer dans le tas.
Conservant un incroyable souvenir du mode bac-à-sable de Toy Story 3, j’espérais également beaucoup de l’aspect construction du titre. Mais encore une fois, la proposition est survolée et peinera certainement à conquérir les plus jeunes. Elle permet simplement de décorer le hub central avec une petite quantité de structures pré-établie, avec lesquelles il est impossible ou presque d’interagir. Joli, mais peu inspiré donc.
LEGO HORIZON ADVENTURES (2024)
★☆☆☆☆
![]()
 Il y a un avant et après DOOM Eternal, comme il y a eu un avant et après DOOM premier du nom. Si ce dernier est la pierre angulaire du FPS, Eternal, lui, incarne son point culminant. Il n’est plus ce simple défouloir, cette profusion d’hémoglobines pour les amateurs et amatrices de sensations fortes, mais s’ouvre à la stratégie en décuplant les intentions – trop timides – de son prédécesseur, le reboot de 2016. La survie du Doom Guy dépend désormais de sa faculté à observer le champ de bataille et à réagir en conséquence. Ainsi, les affrontements se présentent comme des puzzles où le choix du bon outil est la clef de la victoire : contrairement à The Dark Ages, sa suite, et à la concurrence, où les armes se prévalent les unes des autres, ici, chaque équipement bénéficie de sa réponse pour alimenter l’organicité des gunfights et pousser le joueur ou la joueuse à utiliser tout ce qui est à sa disposition – une logique parfaitement incarnée par la sainte-trinité Glory Kill, lance-flammes et tronçonneuse, dont les effets servent autant au combat qu’à obtenir de la vie, de l’armure et des munitions. Les démons ont, quant à eux, leurs forces et leurs faiblesses, qui sont mises à mal par des armes spécifiques : le canon lourd aide par exemple à déloger les structures métalliques qui composent les monstres ; le fusil à plasma permet de venir à bout des boucliers énergétiques ; le lance-grenades se présente comme l’arme idéale pour exterminer les menaces volantes. Tout simplement parfait !
Il y a un avant et après DOOM Eternal, comme il y a eu un avant et après DOOM premier du nom. Si ce dernier est la pierre angulaire du FPS, Eternal, lui, incarne son point culminant. Il n’est plus ce simple défouloir, cette profusion d’hémoglobines pour les amateurs et amatrices de sensations fortes, mais s’ouvre à la stratégie en décuplant les intentions – trop timides – de son prédécesseur, le reboot de 2016. La survie du Doom Guy dépend désormais de sa faculté à observer le champ de bataille et à réagir en conséquence. Ainsi, les affrontements se présentent comme des puzzles où le choix du bon outil est la clef de la victoire : contrairement à The Dark Ages, sa suite, et à la concurrence, où les armes se prévalent les unes des autres, ici, chaque équipement bénéficie de sa réponse pour alimenter l’organicité des gunfights et pousser le joueur ou la joueuse à utiliser tout ce qui est à sa disposition – une logique parfaitement incarnée par la sainte-trinité Glory Kill, lance-flammes et tronçonneuse, dont les effets servent autant au combat qu’à obtenir de la vie, de l’armure et des munitions. Les démons ont, quant à eux, leurs forces et leurs faiblesses, qui sont mises à mal par des armes spécifiques : le canon lourd aide par exemple à déloger les structures métalliques qui composent les monstres ; le fusil à plasma permet de venir à bout des boucliers énergétiques ; le lance-grenades se présente comme l’arme idéale pour exterminer les menaces volantes. Tout simplement parfait !
Si vivement critiquées, les phases de plates-formes sont de leurs côtés essentielles à la bonne digestion de l’œuvre. Elles permettent de la rythmer, de créer des sas de décompression après une trop forte surcharge d’informations pour celui ou celle qui tient la manette. Sans ces moments de respirations, le titre serait étouffant et paraîtrait davantage répétitif.
DOOM ETERNAL (2020)
★★★★☆
![]()
 Dans les mains de Full Circle, la formule inaugurée par Black Box à la fin des années 2000 a quelque peu évolué : elle s’est ouverte aux nouvelles tendances afin de se montrer plus accessible et surtout plus sociale. Free-to-play oblige, skate. est avant tout une production multijoueur. 150 skateurs et skateuses se retrouvent au cœur de San Van, une contrée colorée où « spot » rime bien souvent avec verticalité. De la plus petite maison au plus haut building de la ville, ici, tout peut être escaladé, seul ou à plusieurs, pour se dégoter le lieu rêvé. En haut d’un gratte-ciel sont nichés un skate park planqué et, à nouveau, une armée de joueurs et de joueuses. Chacun et chacune s’amuse à rider ce même muret – en boucle –, à s’installer dans un fauteuil douillet pour observer les gamelles des uns et les prouesses des autres. Si skate. retrouve avec aisance les sensations d’autrefois, ce réalisme qui ravira sans aucun doute les fans de la première heure, et s’essaie également au grand n’importe quoi pour toucher un public plus large, sa plus grande réussite est de parvenir à matérialiser l’énergie communautaire de ce sport. Faire preuve d’imagination, comme monter un kicker grâce au menu création pour sauter par-dessus un 4×4, permet bien souvent de se forger des amitiés ainsi que des souvenirs inoubliables. ♦ Retrouver la critique sur Jeux Vidéo Magazine
Dans les mains de Full Circle, la formule inaugurée par Black Box à la fin des années 2000 a quelque peu évolué : elle s’est ouverte aux nouvelles tendances afin de se montrer plus accessible et surtout plus sociale. Free-to-play oblige, skate. est avant tout une production multijoueur. 150 skateurs et skateuses se retrouvent au cœur de San Van, une contrée colorée où « spot » rime bien souvent avec verticalité. De la plus petite maison au plus haut building de la ville, ici, tout peut être escaladé, seul ou à plusieurs, pour se dégoter le lieu rêvé. En haut d’un gratte-ciel sont nichés un skate park planqué et, à nouveau, une armée de joueurs et de joueuses. Chacun et chacune s’amuse à rider ce même muret – en boucle –, à s’installer dans un fauteuil douillet pour observer les gamelles des uns et les prouesses des autres. Si skate. retrouve avec aisance les sensations d’autrefois, ce réalisme qui ravira sans aucun doute les fans de la première heure, et s’essaie également au grand n’importe quoi pour toucher un public plus large, sa plus grande réussite est de parvenir à matérialiser l’énergie communautaire de ce sport. Faire preuve d’imagination, comme monter un kicker grâce au menu création pour sauter par-dessus un 4×4, permet bien souvent de se forger des amitiés ainsi que des souvenirs inoubliables. ♦ Retrouver la critique sur Jeux Vidéo Magazine
SKATE. (2025)
★★★★☆
![]()
 Fort d’un premier épisode – en une année, DOOM rapporte à la petite équipe d’id un bénéfice de plus de cinq millions de dollars –, DOOM II se sent pousser des ailes. Il compte repousser les limites techniques du médium en multipliant le nombre d’ennemis à l’écran d’un côté, et en décloisonnant les espaces du premier jeu de l’autre ; désormais, les niveaux sont ouverts et se déroulent en extérieur. Mais cette virtuosité est en vérité un cache-misère : si DOOM II se veut plus impressionnant, plus tape-à-l’œil, c’est pour mieux nous faire oublier la pauvreté de son level-design, pourtant principale force de son aîné. Les espaces, autrefois étouffants, sont désormais vides – ils ressemblent à de gigantesques arènes – et, malgré tout, extrêmement mal construits. Pour retrouver l’aspect labyrinthique d’antan, les environnements de ce second chapitre perdent toute logique et multiplient la présence d’ascenseurs, de téléporteurs, de zones toxiques. Et plus on avance dans le jeu, plus c’est laborieux. Autrement dit, DOOM II, c’est DOOM mais sans génie.
Fort d’un premier épisode – en une année, DOOM rapporte à la petite équipe d’id un bénéfice de plus de cinq millions de dollars –, DOOM II se sent pousser des ailes. Il compte repousser les limites techniques du médium en multipliant le nombre d’ennemis à l’écran d’un côté, et en décloisonnant les espaces du premier jeu de l’autre ; désormais, les niveaux sont ouverts et se déroulent en extérieur. Mais cette virtuosité est en vérité un cache-misère : si DOOM II se veut plus impressionnant, plus tape-à-l’œil, c’est pour mieux nous faire oublier la pauvreté de son level-design, pourtant principale force de son aîné. Les espaces, autrefois étouffants, sont désormais vides – ils ressemblent à de gigantesques arènes – et, malgré tout, extrêmement mal construits. Pour retrouver l’aspect labyrinthique d’antan, les environnements de ce second chapitre perdent toute logique et multiplient la présence d’ascenseurs, de téléporteurs, de zones toxiques. Et plus on avance dans le jeu, plus c’est laborieux. Autrement dit, DOOM II, c’est DOOM mais sans génie.
DOOM II : HELL ON EARTH (1994)
★★☆☆☆
![]()
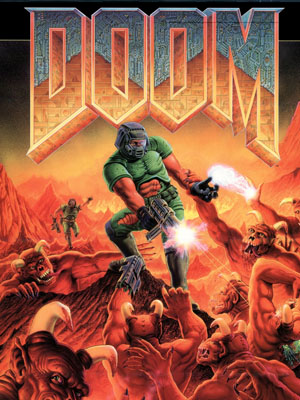 DOOM ne se contente pas d’être un morceau d’histoire, le pilier d’un genre nouveau. Sa vue subjective, sa vitesse de jeu et sa violence qui lui a valu quelques poursuites judiciaires ne sont que la partie émergée de son excellence. Si le hit d’id Software, plus de trente ans après son lancement, influence des productions modernes et accueille régulièrement de nouvelles mises à jour (aussi bien de contenu que de confort de jeu), c’est qu’il est, lui aussi, résolument moderne. Un long couloir plongé dans l’obscurité ; une multitude de portes à gauche comme à droite pour autant d’embranchements ; puis un rugissement suivi d’un coup de feu soudain qui fait surgir de l’ombre un diablotin : encore aujourd’hui, la création d’id surprend par son sens aigu de la mise en scène. Contrairement à bon nombre de ses héritiers ou même de certaines de ses suites qui ne sont que de simples défouloirs, DOOM provoque l’effroi en jouant habilement avec le rythme, la lumière et le son, et surtout un level-design labyrinthique, génie du mal, qui donne l’étrange sensation de s’immerger toujours plus profondément au cœur des limbes. DOOM, c’est le roi du FPS, tout simplement.
DOOM ne se contente pas d’être un morceau d’histoire, le pilier d’un genre nouveau. Sa vue subjective, sa vitesse de jeu et sa violence qui lui a valu quelques poursuites judiciaires ne sont que la partie émergée de son excellence. Si le hit d’id Software, plus de trente ans après son lancement, influence des productions modernes et accueille régulièrement de nouvelles mises à jour (aussi bien de contenu que de confort de jeu), c’est qu’il est, lui aussi, résolument moderne. Un long couloir plongé dans l’obscurité ; une multitude de portes à gauche comme à droite pour autant d’embranchements ; puis un rugissement suivi d’un coup de feu soudain qui fait surgir de l’ombre un diablotin : encore aujourd’hui, la création d’id surprend par son sens aigu de la mise en scène. Contrairement à bon nombre de ses héritiers ou même de certaines de ses suites qui ne sont que de simples défouloirs, DOOM provoque l’effroi en jouant habilement avec le rythme, la lumière et le son, et surtout un level-design labyrinthique, génie du mal, qui donne l’étrange sensation de s’immerger toujours plus profondément au cœur des limbes. DOOM, c’est le roi du FPS, tout simplement.
DOOM (1993)
★★★★★
![]()
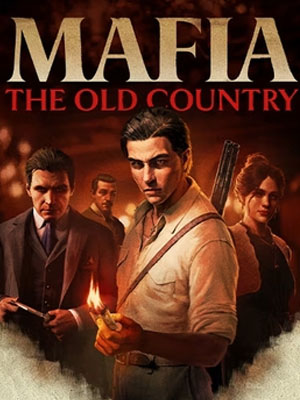 Pour ne pas répéter les erreurs de Mafia III, sa structure bac-à-sable incitant à l’errance, Mafia : The Old Country souhaite être l’incarnation de la machine hollywoodienne. Entre romance impossible, gangsters à la voix rocailleuse, tirades cinglantes et décors paradisiaques, tout renvoie à l’imagerie véhiculée par les plus grands classiques du 7e Art. Et si la formule – largement portée par ses personnages et sa variété de situations (cf. le chapitre Spirito Sportivo) – fait son effet, le soft n’arrive néanmoins pas à se détacher de son modèle pour pleinement se saisir des spécificités de son médium. Ainsi, le monde, pourtant magnifique terrain de jeu, laisse sans cesse entrevoir ses limites : ici, une barrière infranchissable et des champs comme murs invisibles ; là, une boutique dans lequel le joueur ou la joueuse ne se rendra jamais ; à présent, des éléments figés qui ne réagissent à aucune action réalisée par le héros. Le monde « ouvert » n’est qu’un gigantesque plateau de cinéma au service de la narration, il n’est qu’un décor factice, une maquette, un fond vert, qui se détériore à chaque fois que l’avatar essaie de sortir du cadre.
Pour ne pas répéter les erreurs de Mafia III, sa structure bac-à-sable incitant à l’errance, Mafia : The Old Country souhaite être l’incarnation de la machine hollywoodienne. Entre romance impossible, gangsters à la voix rocailleuse, tirades cinglantes et décors paradisiaques, tout renvoie à l’imagerie véhiculée par les plus grands classiques du 7e Art. Et si la formule – largement portée par ses personnages et sa variété de situations (cf. le chapitre Spirito Sportivo) – fait son effet, le soft n’arrive néanmoins pas à se détacher de son modèle pour pleinement se saisir des spécificités de son médium. Ainsi, le monde, pourtant magnifique terrain de jeu, laisse sans cesse entrevoir ses limites : ici, une barrière infranchissable et des champs comme murs invisibles ; là, une boutique dans lequel le joueur ou la joueuse ne se rendra jamais ; à présent, des éléments figés qui ne réagissent à aucune action réalisée par le héros. Le monde « ouvert » n’est qu’un gigantesque plateau de cinéma au service de la narration, il n’est qu’un décor factice, une maquette, un fond vert, qui se détériore à chaque fois que l’avatar essaie de sortir du cadre.
Malgré son approche filmique assumée et le fait qu’il n’arrive pas à exploiter le langage vidéoludique, manette en mains, le titre ne parvient pas à faire oublier ce qu’il est, accentuant d’autant plus un sentiment d’artificialité : ce nouvel opus enchaîne les incohérences scénaristiques en s’appuyant maladroitement sur les poncifs du jeu d’action-aventure. L’univers et les relations entre les clans n’évoluent qu’en la présence d’Enzo Favara, le héros. Et pourtant membre de la famille Torrisi, ce dernier opère toujours en solitaire : il vide seul des repaires remplis de bandits, assassine seul les plus importants chefs de la pègre… dans des séquences d’action d’ailleurs tiraillées entre bestialité bienvenue et trop grande timidité. Chaque choix, comme les munitions restreintes qui ont été au cœur de la campagne marketing, est freiné par des questions d’accessibilité, même dans les plus hautes difficultés. En somme, Mafia : The Old Country semble davantage guidé par un budget limité imposé, plutôt que par de véritables affinités artistiques.
MAFIA : THE OLD COUNTRY (2025)
★★☆☆☆
![]()
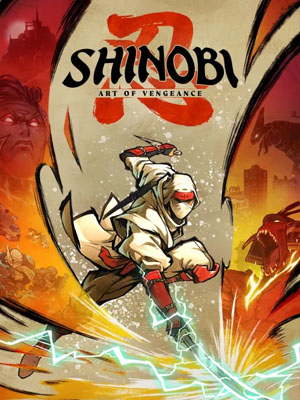 Voir mon héros d’enfance ressusciter ne peut que me réchauffer le cœur, d’autant plus que l’on retrouve Lizardcube à la barre, qui se plaît à remettre en lumière les icônes SEGA de l’ère Nakayama – l’homme a notamment étendu l’influence de l’autrefois constructeur japonais en dehors de sa terre natale grâce à la mise en chantier de productions destinées aux Américains, dont les jeux Shinobi. Mais si Art of Vengeance bénéficie d’une réalisation à la hauteur du talent de Lizardcube, entre esquisses crayonnées et animations à couper le souffle, le soft navigue maladroitement entre plusieurs genres vidéoludiques. Les phases les plus réussies restent indéniablement la partie beat’em up – force du studio – qui fait ici fi de toute difficulté afin de laisser place à de magnifiques chorégraphies : le ninja n’a jamais été aussi agile, il passe d’un ennemi à l’autre sans mal, jongle avec ses adversaires dans les airs, enchaîne dès les premières minutes des combos gargantuesques. Cette absence de difficulté est étonnamment contrebalancée par des phases de plates-formes millimétrées, exigeantes, voire capricieuses, dans des environnements manquant par ailleurs bien souvent de caractère et défiant toutes logiques – des défauts, récurrent des platformers, qui s’accentuent au fur et à mesure que l’on progresse dans l’aventure. Et parce qu’il est dans l’air du temps de tout faire quitte à mal faire, le jeu s’essaie également au metroidvania, simplement pour allonger la durée de vie et cocher la case à la mode plutôt que par volonté créative, ce qui le handicape en le renvoyant directement face aux ténors du genre, Hollow Knight en tête. En d’autres termes, Shinobi : Art of Vengeance, c’est un joli retour mais qui aurait mérité un meilleur encadrement.
Voir mon héros d’enfance ressusciter ne peut que me réchauffer le cœur, d’autant plus que l’on retrouve Lizardcube à la barre, qui se plaît à remettre en lumière les icônes SEGA de l’ère Nakayama – l’homme a notamment étendu l’influence de l’autrefois constructeur japonais en dehors de sa terre natale grâce à la mise en chantier de productions destinées aux Américains, dont les jeux Shinobi. Mais si Art of Vengeance bénéficie d’une réalisation à la hauteur du talent de Lizardcube, entre esquisses crayonnées et animations à couper le souffle, le soft navigue maladroitement entre plusieurs genres vidéoludiques. Les phases les plus réussies restent indéniablement la partie beat’em up – force du studio – qui fait ici fi de toute difficulté afin de laisser place à de magnifiques chorégraphies : le ninja n’a jamais été aussi agile, il passe d’un ennemi à l’autre sans mal, jongle avec ses adversaires dans les airs, enchaîne dès les premières minutes des combos gargantuesques. Cette absence de difficulté est étonnamment contrebalancée par des phases de plates-formes millimétrées, exigeantes, voire capricieuses, dans des environnements manquant par ailleurs bien souvent de caractère et défiant toutes logiques – des défauts, récurrent des platformers, qui s’accentuent au fur et à mesure que l’on progresse dans l’aventure. Et parce qu’il est dans l’air du temps de tout faire quitte à mal faire, le jeu s’essaie également au metroidvania, simplement pour allonger la durée de vie et cocher la case à la mode plutôt que par volonté créative, ce qui le handicape en le renvoyant directement face aux ténors du genre, Hollow Knight en tête. En d’autres termes, Shinobi : Art of Vengeance, c’est un joli retour mais qui aurait mérité un meilleur encadrement.
SHINOBI : ART OF VENGEANCE (2025)
★★☆☆☆
![]()
 Contre toute attente, troquer Vicarious Visions, biberonné à la formule Neversoft depuis toujours, contre Iron Galaxy, novice dans le domaine du jeu de skate, a finalement été pour le mieux. Cela a permis de marquer la distance avec les matériaux originaux, de se réapproprier quelque peu la recette vieille de plus de vingt ans. Contrairement à THPS 1+2 qui s’enferme dans la structure de son modèle, quitte à faire émerger de multiples erreurs, ce THPS 3+4 débarque avec une vision double : harmoniser les intentions d’une franchise qui s’était éparpillée et rendre hommage à l’ère arcade. D’un côté, l’épisode 4 de 3+4 oublie sa dimension bac-à-sable initiale et renoue avec les règles dîtes « classics » des trois premiers opus. On retrouve ainsi le schéma qui a déjà fait ses preuves : une run de deux minutes pour une dizaine d’objectifs à remplir. De l’autre, il ajoute des niveaux inédits multipliant les tremplins permettant de défier les lois de la gravité et d’exploser les scores. Parc Aquatique ressemble par exemple à un roller-coaster géant, tandis que Flipper – plus intéressant encore – porte bien son nom. Ces prises de liberté par rapport aux versions des années 2000 ajoutent un goût de renouveau à une licence qui en avait bien besoin. Une véritable réussite donc ! ♦ Retrouver la critique sur Jeux Vidéo Magazine
Contre toute attente, troquer Vicarious Visions, biberonné à la formule Neversoft depuis toujours, contre Iron Galaxy, novice dans le domaine du jeu de skate, a finalement été pour le mieux. Cela a permis de marquer la distance avec les matériaux originaux, de se réapproprier quelque peu la recette vieille de plus de vingt ans. Contrairement à THPS 1+2 qui s’enferme dans la structure de son modèle, quitte à faire émerger de multiples erreurs, ce THPS 3+4 débarque avec une vision double : harmoniser les intentions d’une franchise qui s’était éparpillée et rendre hommage à l’ère arcade. D’un côté, l’épisode 4 de 3+4 oublie sa dimension bac-à-sable initiale et renoue avec les règles dîtes « classics » des trois premiers opus. On retrouve ainsi le schéma qui a déjà fait ses preuves : une run de deux minutes pour une dizaine d’objectifs à remplir. De l’autre, il ajoute des niveaux inédits multipliant les tremplins permettant de défier les lois de la gravité et d’exploser les scores. Parc Aquatique ressemble par exemple à un roller-coaster géant, tandis que Flipper – plus intéressant encore – porte bien son nom. Ces prises de liberté par rapport aux versions des années 2000 ajoutent un goût de renouveau à une licence qui en avait bien besoin. Une véritable réussite donc ! ♦ Retrouver la critique sur Jeux Vidéo Magazine
TONY HAWK’S PRO SKATER 3+4 (2025)
★★★☆☆
![]()
 MindsEye a été condamné par l’avidité même de son créateur : Leslie Benzies. La mention « d’après le producteur de Grand Theft Auto » a imposé au jeu le standard d’une superbe production signée Rockstar Games, bénéficiant aussi bien d’une armée d’employés que d’un budget sans fond. Ce n’est pas le cas de MindsEye, façonné avec les moyens du bord, ceux d’un studio nouvellement né. En résulte un titre aux ambitions écrasées : lui qui devait convoquer Roblox et GTA, se contente finalement de n’être qu’un jeu d’action à la sauce science-fiction. Et même ça, il le fait mal ! Outre la dimension technique qui a fait couler beaucoup d’encre, le jeu accuse son âge, aussi bien du côté de ses gunfights, qui rappellent les premiers pas de la septième génération de machines, que de sa narration, absolument sans fond. Les scripts, de leurs côtés, renvoient constamment MindsEye à son statut de jeu vidéo, à l’image de cette séquence où des « poursuivants » attendent que la personne derrière l’écran cherche à les semer – autrement dit, joue le jeu – pour enclencher le mode « course-poursuite ». Dans le cas contraire, ils se contenteront de se garer inoffensivement au côté de la voiture de l’avatar. Il ne reste alors que Redrock City, une ville joliment construite, inspirée, qui aurait pu faire un bon terrain de jeu. ♦ Retrouver la critique sur Jeux Vidéo Magazine
MindsEye a été condamné par l’avidité même de son créateur : Leslie Benzies. La mention « d’après le producteur de Grand Theft Auto » a imposé au jeu le standard d’une superbe production signée Rockstar Games, bénéficiant aussi bien d’une armée d’employés que d’un budget sans fond. Ce n’est pas le cas de MindsEye, façonné avec les moyens du bord, ceux d’un studio nouvellement né. En résulte un titre aux ambitions écrasées : lui qui devait convoquer Roblox et GTA, se contente finalement de n’être qu’un jeu d’action à la sauce science-fiction. Et même ça, il le fait mal ! Outre la dimension technique qui a fait couler beaucoup d’encre, le jeu accuse son âge, aussi bien du côté de ses gunfights, qui rappellent les premiers pas de la septième génération de machines, que de sa narration, absolument sans fond. Les scripts, de leurs côtés, renvoient constamment MindsEye à son statut de jeu vidéo, à l’image de cette séquence où des « poursuivants » attendent que la personne derrière l’écran cherche à les semer – autrement dit, joue le jeu – pour enclencher le mode « course-poursuite ». Dans le cas contraire, ils se contenteront de se garer inoffensivement au côté de la voiture de l’avatar. Il ne reste alors que Redrock City, une ville joliment construite, inspirée, qui aurait pu faire un bon terrain de jeu. ♦ Retrouver la critique sur Jeux Vidéo Magazine
MINDSEYE (2025)
★☆☆☆☆
![]()
 Là où The Witcher 3 : Wild Hunt se détache d’une certaine manière de ses origines, en adoptant pleinement les codes du RPG occidental, Thronebreaker façonne un pont évident entre jeu vidéo et littérature : il est un conte sur lequel il est possible d’influer. Si les grandes lignes sont pré-écrites et indéboulonnables, chaque petite quête, qui se résout en partie par une bataille de Gwynt, donne à entendre – littéralement – deux voix possibles. Pendant que la Reine Meve, l’héroïne, se déplace dans un monde en 3D isométrique arborant des visuels en cel-shading, le personnage, surnommé le conteur, ensorcelle de sa voix(-off) l’image et les actions à l’écran. Et c’est en partie là, tout le génie du jeu : en faisant de cette histoire un récit modulable, le titre renoue avec les origines mêmes du genre narratif – des récits oraux offerts en spectacle qui animaient villes et villages et se métamorphosaient au gré du conteur et de l’auditoire. Les choix qui rythment l’ensemble des péripéties donnent ainsi l’impression que le narrateur improvise, qu’il cherche à tout prix à captiver la personne qui tient la manette. Ceci explique peut-être le caractère mirobolant de cette aventure : contrairement à ce que peut laisser penser le premier acte du jeu (sur six), il ne s’agit pas simplement d’un récit de guerre entre les Lyriens et les Nilfgaardiens, mais d’une véritable épopée, contenant son lot de rebondissements, entre traîtrises et alliances invraisemblables. Un petit chef-d’œuvre, tout simplement. ♦ Retrouver l’analyse dans le Hors-Série Jeux Vidéo Magazine – The Witcher
Là où The Witcher 3 : Wild Hunt se détache d’une certaine manière de ses origines, en adoptant pleinement les codes du RPG occidental, Thronebreaker façonne un pont évident entre jeu vidéo et littérature : il est un conte sur lequel il est possible d’influer. Si les grandes lignes sont pré-écrites et indéboulonnables, chaque petite quête, qui se résout en partie par une bataille de Gwynt, donne à entendre – littéralement – deux voix possibles. Pendant que la Reine Meve, l’héroïne, se déplace dans un monde en 3D isométrique arborant des visuels en cel-shading, le personnage, surnommé le conteur, ensorcelle de sa voix(-off) l’image et les actions à l’écran. Et c’est en partie là, tout le génie du jeu : en faisant de cette histoire un récit modulable, le titre renoue avec les origines mêmes du genre narratif – des récits oraux offerts en spectacle qui animaient villes et villages et se métamorphosaient au gré du conteur et de l’auditoire. Les choix qui rythment l’ensemble des péripéties donnent ainsi l’impression que le narrateur improvise, qu’il cherche à tout prix à captiver la personne qui tient la manette. Ceci explique peut-être le caractère mirobolant de cette aventure : contrairement à ce que peut laisser penser le premier acte du jeu (sur six), il ne s’agit pas simplement d’un récit de guerre entre les Lyriens et les Nilfgaardiens, mais d’une véritable épopée, contenant son lot de rebondissements, entre traîtrises et alliances invraisemblables. Un petit chef-d’œuvre, tout simplement. ♦ Retrouver l’analyse dans le Hors-Série Jeux Vidéo Magazine – The Witcher
THRONEBREAKER (2018)
★★★★☆
![]()
 Le passage à la troisième dimension pour Mario s’est conclu par un changement drastique de formule : une ouverture sur le monde, un penchant – finalement – pour le réalisme. Il a fallu attendre 2011, avec Super Mario 3D Land, et 2013, avec Super Mario 3D World, pour que la recette des premiers pas du plombier moustachu soit enfin transposée en 3D. On retrouve ces espaces fantaisistes, sans réelles connexions logiques, spécialement pensés et conçus pour une approche ludique, mais avec la possibilité nouvelle de jouer avec la profondeur. C’est ici une manière de briser les attentes, de casser le rythme en cours de niveau en s’amusant avec la perspective, d’incarner l’entre-deux nécessaire entre Super Mario Bros. de 1985 et Super Mario 64 de 1996. Néanmoins, je trouve que ce 3D World délaisse un peu trop la plateforme des premiers jours au profit de l’accessibilité, ces nombreux costumes qui permettent bien souvent de sauter toutes les séquences qui demandent un minimum de doigté.
Le passage à la troisième dimension pour Mario s’est conclu par un changement drastique de formule : une ouverture sur le monde, un penchant – finalement – pour le réalisme. Il a fallu attendre 2011, avec Super Mario 3D Land, et 2013, avec Super Mario 3D World, pour que la recette des premiers pas du plombier moustachu soit enfin transposée en 3D. On retrouve ces espaces fantaisistes, sans réelles connexions logiques, spécialement pensés et conçus pour une approche ludique, mais avec la possibilité nouvelle de jouer avec la profondeur. C’est ici une manière de briser les attentes, de casser le rythme en cours de niveau en s’amusant avec la perspective, d’incarner l’entre-deux nécessaire entre Super Mario Bros. de 1985 et Super Mario 64 de 1996. Néanmoins, je trouve que ce 3D World délaisse un peu trop la plateforme des premiers jours au profit de l’accessibilité, ces nombreux costumes qui permettent bien souvent de sauter toutes les séquences qui demandent un minimum de doigté.
SUPER MARIO 3D WORLD (2013)
★★★☆☆
![]()
 Il y a quelque chose de fort chez Blue Prince, un gigantesque mystère qui s’épaissit à vue d’œil, incarné par cette maison à l’architecture volatile, dont les murs se font et se défont au fil des jours et renferment des secrets enchevêtrés les uns dans les autres. C’est ça : des puzzles éparpillés qui viennent déplier de nouvelles perspectives, de nouvelles pistes à explorer, afin de mener à un ensemble bien plus grand. Celui-ci, on s’amuse à le coucher sur papier, à l’imaginer tout au long de la journée, puisque Blue Prince a en effet cette faculté d’occuper l’esprit, d’étendre la séance de jeu en dehors des moments passés devant l’écran. Néanmoins, héritier du genre rogue-like, le titre se montre également frustrant, via ses mécaniques d’abord, qui imposent la défaite, poussent encore et encore à recommencer des parties, la faute à des déplacements limités et un aléatoire qui n’est que rarement de notre côté. Une idée que l’on veut matérialiser peut ainsi prendre plusieurs runs avant d’exister. Certaines résolutions peuvent par ailleurs ne pas être suffisamment satisfaisantes, dévoilant soit des évidences que l’on avait déjà devinées, soit des récompenses bien trop maigres par rapport à l’effort fourni. Malgré tout, Blue Prince reste un très bon puzzle-game que je recommande si vous avez du temps à lui consacrer.
Il y a quelque chose de fort chez Blue Prince, un gigantesque mystère qui s’épaissit à vue d’œil, incarné par cette maison à l’architecture volatile, dont les murs se font et se défont au fil des jours et renferment des secrets enchevêtrés les uns dans les autres. C’est ça : des puzzles éparpillés qui viennent déplier de nouvelles perspectives, de nouvelles pistes à explorer, afin de mener à un ensemble bien plus grand. Celui-ci, on s’amuse à le coucher sur papier, à l’imaginer tout au long de la journée, puisque Blue Prince a en effet cette faculté d’occuper l’esprit, d’étendre la séance de jeu en dehors des moments passés devant l’écran. Néanmoins, héritier du genre rogue-like, le titre se montre également frustrant, via ses mécaniques d’abord, qui imposent la défaite, poussent encore et encore à recommencer des parties, la faute à des déplacements limités et un aléatoire qui n’est que rarement de notre côté. Une idée que l’on veut matérialiser peut ainsi prendre plusieurs runs avant d’exister. Certaines résolutions peuvent par ailleurs ne pas être suffisamment satisfaisantes, dévoilant soit des évidences que l’on avait déjà devinées, soit des récompenses bien trop maigres par rapport à l’effort fourni. Malgré tout, Blue Prince reste un très bon puzzle-game que je recommande si vous avez du temps à lui consacrer.
BLUE PRINCE (2025)
★★★☆☆
![]()
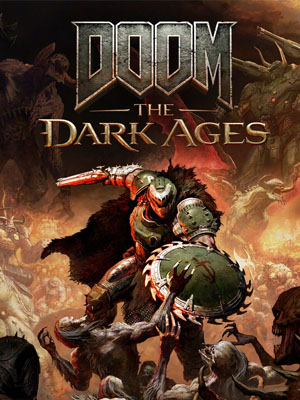 La saga DOOM est de retour, et avec elle, The Dark Ages, un épisode qui – à l’image du reboot de 2016 – réalise un aller-simple dans le jeu vidéo des années 1990 : le médium dans toute sa non-subtilité. Il matérialise un étalage de mauvais goût assumé : de gros guns, des démons en guise de chair à canon, des litres d’hémoglobines et des environnements gothiques pour une expérience qui se vie à mille à l’heure. Placement, mobilité, observation du champ de bataille, réactions à la seconde près, les affrontements sont intenses et font appel à tous les sens : tout simplement une démonstration de ce qu’est l’art du gameplay – un défouloir au challenge de taille et maitrisé. Les années passent et la franchise pierre angulaire du FPS reste au-dessus du lot, une référence pour ses semblables. La série est tellement bien installée au sein du paysage qu’elle se permet de déjouer les attentes. Le level-design vertical exemplaire d’Eternal passe à la trappe, à la place, l’action de The Dark Ages est davantage fixée au sol, en adéquation avec le nouveau Slayer, un chevalier qui pèse son poids et favorisant toujours plus le contact, les enchaînements au corps-à-corps. La quasi-disparition des Glory Kills – des finish-moves qui permettent de reprendre son souffle – continue d’acheminer la nervosité et la brutalité de la franchise : désormais, il n’y a plus aucun temps mort. Cette mentalité nouvelle – un retour aux racines finalement – est l’occasion idéale pour employer des mécaniques inédites aussi bien tirées du shoot’em up (il y a une vibe Returnal loin d’être déplaisante) que du jeu de rythme – ce coup de bouclier que l’on martèle à fréquence régulière pour renvoyer la tonne de projectiles sous un vacarme assourdissant. Et si beaucoup regrettent la bande originale de Mick Gordon, la disparition de cette dernière permet en contre-partie de mettre l’emphase sur le sound-design, un argument oublié des précédentes itérations : enfin le bruit des pétoires est égal à leur puissance.
La saga DOOM est de retour, et avec elle, The Dark Ages, un épisode qui – à l’image du reboot de 2016 – réalise un aller-simple dans le jeu vidéo des années 1990 : le médium dans toute sa non-subtilité. Il matérialise un étalage de mauvais goût assumé : de gros guns, des démons en guise de chair à canon, des litres d’hémoglobines et des environnements gothiques pour une expérience qui se vie à mille à l’heure. Placement, mobilité, observation du champ de bataille, réactions à la seconde près, les affrontements sont intenses et font appel à tous les sens : tout simplement une démonstration de ce qu’est l’art du gameplay – un défouloir au challenge de taille et maitrisé. Les années passent et la franchise pierre angulaire du FPS reste au-dessus du lot, une référence pour ses semblables. La série est tellement bien installée au sein du paysage qu’elle se permet de déjouer les attentes. Le level-design vertical exemplaire d’Eternal passe à la trappe, à la place, l’action de The Dark Ages est davantage fixée au sol, en adéquation avec le nouveau Slayer, un chevalier qui pèse son poids et favorisant toujours plus le contact, les enchaînements au corps-à-corps. La quasi-disparition des Glory Kills – des finish-moves qui permettent de reprendre son souffle – continue d’acheminer la nervosité et la brutalité de la franchise : désormais, il n’y a plus aucun temps mort. Cette mentalité nouvelle – un retour aux racines finalement – est l’occasion idéale pour employer des mécaniques inédites aussi bien tirées du shoot’em up (il y a une vibe Returnal loin d’être déplaisante) que du jeu de rythme – ce coup de bouclier que l’on martèle à fréquence régulière pour renvoyer la tonne de projectiles sous un vacarme assourdissant. Et si beaucoup regrettent la bande originale de Mick Gordon, la disparition de cette dernière permet en contre-partie de mettre l’emphase sur le sound-design, un argument oublié des précédentes itérations : enfin le bruit des pétoires est égal à leur puissance.
Dans la bataille, néanmoins, The Dark Ages perd sa dimension stratégique – ce qui fait qu’Eternal lui reste supérieur –, ce côté « jeu d’échec » qui impliquait d’exterminer tel ou tel ennemi en premier pour espérer survivre, de favoriser telle arme dans telle situation et pour venir à bout de tel adversaire. Le lance-grenade n’avait pas que pour but de faire le ménage dans une large zone par exemple, mais servait également à éliminer d’un tir bien placé le Cacodemon, un monstre volant. Le canon lourd, quant à lui, pouvait désassembler les créatures de leur arsenal : une tourelle automatique fixée sur le crâne, un bras mécanique qui tire de gigantesques boulets. Dans The Dark Ages, il est possible d’utiliser la première arme venue pour venir à bout des hordes de démons : elles sont toutes plus ou moins polyvalentes, appuyant peut-être un peu trop le côté décérébré de la franchise. Certainement le principal défaut.
DOOM : THE DARK AGES (2025)
★★★☆☆
![]()
 Tous les éléments qui composent South of Midnight n’est qu’unité : action, narration et musique cohabitent et se répondent sans cesse, et c’est d’ailleurs ce dernier ingrédient qui forme le squelette de l’œuvre. La musique se nourrit de ce qui se déroule à l’écran, elle évolue au gré des faits et gestes d’Hazel, l’héroïne, et, en retour, elle écrit l’histoire : une partition magnifique, changeante, qui réalise une plongée dans les contes folkloriques de la Louisiane. Néanmoins, la force de South of Midnight met aussi l’accent sur ses faiblesses : la musique, véritable moteur de cette aventure, est empreinte de la culture jazz, mouvement qui prône la liberté, l’émancipation par l’improvisation. South of Midnight, lui, certainement contraint par son budget modeste, est fixé sur des rails : le titre refuse toute initiative, toute spontanéité, propose une structure venue tout droit d’un autre âge. Dommage !
Tous les éléments qui composent South of Midnight n’est qu’unité : action, narration et musique cohabitent et se répondent sans cesse, et c’est d’ailleurs ce dernier ingrédient qui forme le squelette de l’œuvre. La musique se nourrit de ce qui se déroule à l’écran, elle évolue au gré des faits et gestes d’Hazel, l’héroïne, et, en retour, elle écrit l’histoire : une partition magnifique, changeante, qui réalise une plongée dans les contes folkloriques de la Louisiane. Néanmoins, la force de South of Midnight met aussi l’accent sur ses faiblesses : la musique, véritable moteur de cette aventure, est empreinte de la culture jazz, mouvement qui prône la liberté, l’émancipation par l’improvisation. South of Midnight, lui, certainement contraint par son budget modeste, est fixé sur des rails : le titre refuse toute initiative, toute spontanéité, propose une structure venue tout droit d’un autre âge. Dommage !
SOUTH OF MIDNIGHT (2025)
★★★☆☆
![]()
 Split Fiction passe à côté de son objectif : sa fin, qui fait montre d’une technicité et d’un concept novateur, le prouve tout à fait. Le jeu aurait dû avoir cette teneur tout du long – quitte à être beaucoup plus court –, au lieu de répéter maladroitement la formule « It Takes Two », et d’y perdre son merveilleux au passage. D’ailleurs, là est le principal souci de Split Fiction qui parle des méfaits de l’I.A. génératrice, sans faire preuve, lui-même, de créativité sur le plan de l’écriture et du visuel. Les environnements sont la majeure partie du temps extrêmement générique, déjà-vus, déjà explorés mille et une fois – en mieux – ailleurs, et cela concerne aussi bien le segment dédié à la science-fiction que celui consacré à la fantasy. Difficile d’être subjugué par ces plates-formes volantes et d’un gris uniforme qui habillent les longues premières heures, difficile d’être sous le charme de ces ogres et autres géants qui provoquent davantage le malaise que la fascination.
Split Fiction passe à côté de son objectif : sa fin, qui fait montre d’une technicité et d’un concept novateur, le prouve tout à fait. Le jeu aurait dû avoir cette teneur tout du long – quitte à être beaucoup plus court –, au lieu de répéter maladroitement la formule « It Takes Two », et d’y perdre son merveilleux au passage. D’ailleurs, là est le principal souci de Split Fiction qui parle des méfaits de l’I.A. génératrice, sans faire preuve, lui-même, de créativité sur le plan de l’écriture et du visuel. Les environnements sont la majeure partie du temps extrêmement générique, déjà-vus, déjà explorés mille et une fois – en mieux – ailleurs, et cela concerne aussi bien le segment dédié à la science-fiction que celui consacré à la fantasy. Difficile d’être subjugué par ces plates-formes volantes et d’un gris uniforme qui habillent les longues premières heures, difficile d’être sous le charme de ces ogres et autres géants qui provoquent davantage le malaise que la fascination.
Malgré tout, grâce au partage, au plaisir de vivre cette aventure à deux, j’ai passé un bon moment. Le fait que les idées et les mécaniques s’améliorent et prennent de l’épaisseur au fil du temps y joue certainement, surtout quand, à la manière d’un A Way Out – toujours l’unique chef-d’œuvre de Josef Fares – le titre multiplie les points de vue et propose simultanément deux situations aux approches diamétralement opposées. Mais ces petits coups de génie et ce final en apothéose – prometteur pour tout ce qu’il ouvre comme perspectives pour l’industrie –, ne parviennent pas à faire oublier le reste, bien souvent maladroit et si peu inspiré.
SPLIT FICTION (2025)
★★☆☆☆
![]()
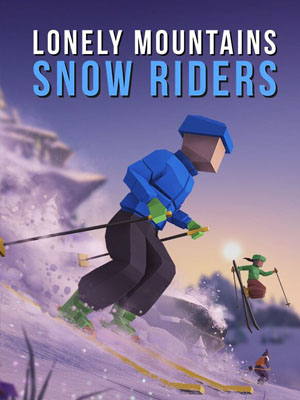 Lonely Mountains, c’est la promesse d’un gigantesque bol d’air frais, le brouhaha des villes laissant place aux chants des oiseaux, et les buildings de verres et de bétons, à des environnements désertiques qui s’étendent à perte de vue. On inspire, puis expire… Lonely Mountains, c’est aussi ce sentiment de plénitude, de pureté – des jeux doudous, comme on dit. On s’arrête parfois pour admirer le paysage : au loin s’affiche une épaisse forêt, un lac gelé, ou encore un gigantesque tremplin naturel – une invitation à survoler un ravin sans fond. Puis on se laisse glisser, d’abord en vélo, dans Downhill, désormais en ski, dans Snow Riders, afin de ne faire qu’un avec les différentes facettes de la montagne : douce et envoûtante, escarpée et dangereuse, un paradis à sensations fortes. Expérimenter, apprendre à les connaître, telle est la clef d’un parcours sans embûche, d’un chronomètre terrassé.
Lonely Mountains, c’est la promesse d’un gigantesque bol d’air frais, le brouhaha des villes laissant place aux chants des oiseaux, et les buildings de verres et de bétons, à des environnements désertiques qui s’étendent à perte de vue. On inspire, puis expire… Lonely Mountains, c’est aussi ce sentiment de plénitude, de pureté – des jeux doudous, comme on dit. On s’arrête parfois pour admirer le paysage : au loin s’affiche une épaisse forêt, un lac gelé, ou encore un gigantesque tremplin naturel – une invitation à survoler un ravin sans fond. Puis on se laisse glisser, d’abord en vélo, dans Downhill, désormais en ski, dans Snow Riders, afin de ne faire qu’un avec les différentes facettes de la montagne : douce et envoûtante, escarpée et dangereuse, un paradis à sensations fortes. Expérimenter, apprendre à les connaître, telle est la clef d’un parcours sans embûche, d’un chronomètre terrassé.
Snow Riders partage exactement la même vocation que son aîné – et c’est ce que l’on attend de lui. Il marque néanmoins l’apparition de petites imperfections, absentes du premier opus. Elles sont aussi bien créées par ce besoin inédit de variété que par l’adoption d’une nouvelle discipline. Le ski ne peut se prendre en main de la même manière qu’un vélo : en étant exclusivement un sport de descente, il est moins dans le contrôle que dans la réaction. Là où un deux-roues permet de s’arrêter, de grimper une côte pour faire un détour se transformant par la suite en raccourci, le ski subit les courbes trop prononcées, suit le sentier tracé dans la neige. En conséquence, il y a moins de place à l’exploration, à l’expérimentation. La recherche de variété, quant à elle, vient détruire cette idée d’unité de lieu qui faisait la force du premier jeu. Le plaisir de retrouver, d’un parcours à l’autre, ces mêmes sentiers a alors disparu. Deux défauts pour un unique résultat : on se détache davantage de cette montagne, devenue circuit, un simple niveau à passer. ♦ Retrouver la critique sur Jeux Vidéo Magazine
LONELY MOUNTAINS : SNOW RIDERS (2025)
★★★☆☆
![]()
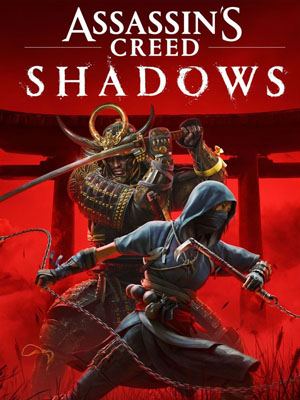 Les feuilles virevoltent, frémissent. Les branches grincent, craquent, se balancent. Les arbres, eux, dansent. De loin, ils ne font qu’un, forment un gigantesque ballet qui bouge au gré du vent, évolue au gré des saisons. Il est tantôt verdoyant, foisonnant, tantôt entièrement dénudé et recouvert d’une fine pellicule blanche. Puis, le brouillard se lève, prend peu à peu possession des rivières, des lacs comme des routes et des villages. Malgré tous les défauts d’Assassin’s Creed Shadows, c’est de sa nature que j’ai envie de me souvenir. Elle partage un sentiment nouveau, une impression de béatitude. S’arrêter en haut d’une colline, profiter du chant des oiseaux, les cheveux de l’avatar au vent et le regard rivé vers l’horizon – infini – devient une habitude, presqu’un rituel, tant chaque point de vue esquisse de magnifiques tableaux. Ce tour de force est en partie le résultat d’un retour aux sources : Odyssey et Valhalla avaient pour objectif de repousser les limites, d’adopter pleinement les codes du bac-à-sable, quittent à oublier la création de leur monde. Shadows, avec ses sous-bois presqu’impenetrables et ses sentiers parfaitement dessinés, donne une direction, oriente le regard. S’affichent alors des curiosités au loin : un temple qui surplombe la vallée, un petit village niché dans le creux de cette dernière, des lieux de culte à l’apparence inaccessible, des forts aux mains des bandits. Cette approche, davantage structurée, régie également le level-design. L’observation redevient une phase de jeu en soi et permet d’exploiter les failles des différents camps, afin de mieux surprendre l’adversaire. Si Shadows n’est toujours pas le chef-d’œuvre espéré, il s’inscrit comme un vent de fraîcheur bienvenue au sein de la franchise. Il est un pas dans la bonne direction !
Les feuilles virevoltent, frémissent. Les branches grincent, craquent, se balancent. Les arbres, eux, dansent. De loin, ils ne font qu’un, forment un gigantesque ballet qui bouge au gré du vent, évolue au gré des saisons. Il est tantôt verdoyant, foisonnant, tantôt entièrement dénudé et recouvert d’une fine pellicule blanche. Puis, le brouillard se lève, prend peu à peu possession des rivières, des lacs comme des routes et des villages. Malgré tous les défauts d’Assassin’s Creed Shadows, c’est de sa nature que j’ai envie de me souvenir. Elle partage un sentiment nouveau, une impression de béatitude. S’arrêter en haut d’une colline, profiter du chant des oiseaux, les cheveux de l’avatar au vent et le regard rivé vers l’horizon – infini – devient une habitude, presqu’un rituel, tant chaque point de vue esquisse de magnifiques tableaux. Ce tour de force est en partie le résultat d’un retour aux sources : Odyssey et Valhalla avaient pour objectif de repousser les limites, d’adopter pleinement les codes du bac-à-sable, quittent à oublier la création de leur monde. Shadows, avec ses sous-bois presqu’impenetrables et ses sentiers parfaitement dessinés, donne une direction, oriente le regard. S’affichent alors des curiosités au loin : un temple qui surplombe la vallée, un petit village niché dans le creux de cette dernière, des lieux de culte à l’apparence inaccessible, des forts aux mains des bandits. Cette approche, davantage structurée, régie également le level-design. L’observation redevient une phase de jeu en soi et permet d’exploiter les failles des différents camps, afin de mieux surprendre l’adversaire. Si Shadows n’est toujours pas le chef-d’œuvre espéré, il s’inscrit comme un vent de fraîcheur bienvenue au sein de la franchise. Il est un pas dans la bonne direction !
ASSASSIN’S CREED SHADOWS (2025)
★★★☆☆
![]()
 Ninja Gaiden II, Sigma 2, ou II Black, pour moi, c’est du pareil au même ! Ce n’est pas un plus grand nombre d’ennemis par-ci ou par-là ou des boss en plus ou en moins qui changent réellement l’expérience. Ninja Gaiden II reste, quoiqu’il arrive, Ninja Gaiden II. D’une version à l’autre, il emporte avec lui son enthousiasme, ses affrontements vifs et violents, ainsi que son lot de déceptions. Les premiers niveaux, ceux qui opposent Ryu Hayabusa à d’autres ninjas, sont magistraux : en plus d’être les plus inspirés artistiquement, ils enseignent une manière de jouer, où l’art du démembrement est aussi bien au service du spectacle que du jeu. La suite est, à l’inverse, plus chaotique. Ce qui a été précédemment inculqué est remisé au placard, la faute à un bestiaire moins inspiré, plus résistant également, qui change la philosophie globale du soft : désormais, la maîtrise des combos prévaut sur le reste. Il suffit alors qu’à marteler les boutons et à enchaîner les arènes au design de plus en plus insipide. Ce qui m’amène à la même conclusion qu’il y a vingt ans : Ninja Gaiden premier du nom – à nouveau, peu importe la version – surpasse ce Ninja Gaiden II. Il est certes moins spectaculaire, mais il est plus juste, plus précis et est mieux rythmé. C’est aussi selon moi le seul de la saga qui mérite son statut de jeu difficile.
Ninja Gaiden II, Sigma 2, ou II Black, pour moi, c’est du pareil au même ! Ce n’est pas un plus grand nombre d’ennemis par-ci ou par-là ou des boss en plus ou en moins qui changent réellement l’expérience. Ninja Gaiden II reste, quoiqu’il arrive, Ninja Gaiden II. D’une version à l’autre, il emporte avec lui son enthousiasme, ses affrontements vifs et violents, ainsi que son lot de déceptions. Les premiers niveaux, ceux qui opposent Ryu Hayabusa à d’autres ninjas, sont magistraux : en plus d’être les plus inspirés artistiquement, ils enseignent une manière de jouer, où l’art du démembrement est aussi bien au service du spectacle que du jeu. La suite est, à l’inverse, plus chaotique. Ce qui a été précédemment inculqué est remisé au placard, la faute à un bestiaire moins inspiré, plus résistant également, qui change la philosophie globale du soft : désormais, la maîtrise des combos prévaut sur le reste. Il suffit alors qu’à marteler les boutons et à enchaîner les arènes au design de plus en plus insipide. Ce qui m’amène à la même conclusion qu’il y a vingt ans : Ninja Gaiden premier du nom – à nouveau, peu importe la version – surpasse ce Ninja Gaiden II. Il est certes moins spectaculaire, mais il est plus juste, plus précis et est mieux rythmé. C’est aussi selon moi le seul de la saga qui mérite son statut de jeu difficile.
NINJA GAIDEN II BLACK (2025)
★★☆☆☆
![]()
 Derrière sa simplicité et ses mécaniques directement issues de l’univers des jeux flash, se cache un véritable bijou qui, pour la première fois au sein de la franchise, allie le fond et la forme. Trials Rising, c’est encore et toujours cette physique irréprochable, soulignée par des sensations grisantes : on a plus que jamais l’impression d’avoir le plein contrôle sur les deux roues affichées à l’écran, de ressentir la pression sur l’accélérateur, la force du frein, la moindre des aspérités des tracés. Et là où Trials Fusion convoque maladroitement la science-fiction pour se différencier de son aîné et apporter une touche de spectaculaire supplémentaire, Rising prend à nouveau vie dans des environnements de tous les jours, tout en s’appuyant sur le principe des montagnes russes afin de créer la surprise. En résultent des circuits sensationnels, dynamiques et surtout, parlants. La licence, en se raccrochant au réel, délivre un discours satirique, engagé : aux commandes d’un engin motorisé – bien entendu polluant –, le titre nous laisse observer de magnifiques zones naturelles défigurées pour la fête, le jeu et les industries dévorantes. Pour renforcer ce triste constat, Rising laisse transparaître le temps qui passe, les sols exploités, infectés par l’espèce humaine, en invitant à parcourir une nouvelle fois des pistes déjà explorées. Ainsi, les eaux laissent place à des mares de pétrole, les terrains vagues à des champs de conteneurs, tandis que les glaciers fondent à vue d’œil. Un grand jeu !
Derrière sa simplicité et ses mécaniques directement issues de l’univers des jeux flash, se cache un véritable bijou qui, pour la première fois au sein de la franchise, allie le fond et la forme. Trials Rising, c’est encore et toujours cette physique irréprochable, soulignée par des sensations grisantes : on a plus que jamais l’impression d’avoir le plein contrôle sur les deux roues affichées à l’écran, de ressentir la pression sur l’accélérateur, la force du frein, la moindre des aspérités des tracés. Et là où Trials Fusion convoque maladroitement la science-fiction pour se différencier de son aîné et apporter une touche de spectaculaire supplémentaire, Rising prend à nouveau vie dans des environnements de tous les jours, tout en s’appuyant sur le principe des montagnes russes afin de créer la surprise. En résultent des circuits sensationnels, dynamiques et surtout, parlants. La licence, en se raccrochant au réel, délivre un discours satirique, engagé : aux commandes d’un engin motorisé – bien entendu polluant –, le titre nous laisse observer de magnifiques zones naturelles défigurées pour la fête, le jeu et les industries dévorantes. Pour renforcer ce triste constat, Rising laisse transparaître le temps qui passe, les sols exploités, infectés par l’espèce humaine, en invitant à parcourir une nouvelle fois des pistes déjà explorées. Ainsi, les eaux laissent place à des mares de pétrole, les terrains vagues à des champs de conteneurs, tandis que les glaciers fondent à vue d’œil. Un grand jeu !
TRIALS RISING (2019)
★★★★★
![]()
 Friday the 13th, Evil Dead, Terminator : Resistance… Depuis près d’une décennie, il y a comme mode de ressusciter au sein même de nos jeux vidéo préférés les monstres d’antan, ceux qui ont fait la joie des blockbusters des années 1980. Et si ces retrouvailles ne sont pas nécessairement synonymes de chefs-d’œuvre (quoi que la question se pose pour Friday the 13th), chacune se présente en de magnifiques making-of – des visites virtuelles et interactives des studios et de leurs décors. RoboCop : Rogue City va évidemment dans ce sens, avec la reproduction à l’échelle 1 du commissariat, véritable bulle temporelle que l’on découvre dans le premier film par deux fois, sous le regard d’Alex Murphy, puis celui de son alter-nécro RoboCop. Plus tard, le jeu s’autorise également un passage du côté de l’aciérie, lieu où Murphy trouve d’ailleurs la mort. Et si cette fois-ci TEYON se permet quelques libertés pour des questions évidentes de level-design, l’ambiance du site est parfaitement retranscrite – c’est fouillé, crédible, crasseux. Cet amour pour les films originaux est à l’échelle de l’œuvre : pour preuve, ce grand retour des acteurs et actrices d’autrefois – ils et elles prêtent leur voix et/ou leur visage (jusqu’à l’absurde). À cela s’ajoutent des clins d’œil en pagaille, au point de calquer la mise en scène, et l’adoption d’un filtre CRT afin de renforcer l’immersion et faciliter l’incarnation. Plus intéressant encore, RoboCop est fidèle à lui-même : que ce soit en facile ou en difficile, il semble indestructible – une véritable machine à tuer.
Friday the 13th, Evil Dead, Terminator : Resistance… Depuis près d’une décennie, il y a comme mode de ressusciter au sein même de nos jeux vidéo préférés les monstres d’antan, ceux qui ont fait la joie des blockbusters des années 1980. Et si ces retrouvailles ne sont pas nécessairement synonymes de chefs-d’œuvre (quoi que la question se pose pour Friday the 13th), chacune se présente en de magnifiques making-of – des visites virtuelles et interactives des studios et de leurs décors. RoboCop : Rogue City va évidemment dans ce sens, avec la reproduction à l’échelle 1 du commissariat, véritable bulle temporelle que l’on découvre dans le premier film par deux fois, sous le regard d’Alex Murphy, puis celui de son alter-nécro RoboCop. Plus tard, le jeu s’autorise également un passage du côté de l’aciérie, lieu où Murphy trouve d’ailleurs la mort. Et si cette fois-ci TEYON se permet quelques libertés pour des questions évidentes de level-design, l’ambiance du site est parfaitement retranscrite – c’est fouillé, crédible, crasseux. Cet amour pour les films originaux est à l’échelle de l’œuvre : pour preuve, ce grand retour des acteurs et actrices d’autrefois – ils et elles prêtent leur voix et/ou leur visage (jusqu’à l’absurde). À cela s’ajoutent des clins d’œil en pagaille, au point de calquer la mise en scène, et l’adoption d’un filtre CRT afin de renforcer l’immersion et faciliter l’incarnation. Plus intéressant encore, RoboCop est fidèle à lui-même : que ce soit en facile ou en difficile, il semble indestructible – une véritable machine à tuer.
Propre aux productions du genre, Rogue City se gâte manette en mains. Passé la surprise de sa violence, de ces ennemis chairs à canon et la joie de camper une boîte de conserve surpuissante, le titre se laisse tomber dans la monotonie. Les massacres s’enchaînent sans parvenir à captiver, la faute, justement, au fait de contrôler un char d’assaut. Les phases d’enquête – pourtant bienvenues – sont, quant à elles, bien trop fixées sur des rails, voire automatisées, pour que l’on puisse se sentir concernés. Si RoboCop : Rogue City est merveilleux par certains aspects, il n’arrive pas à allier le fond et la forme : il a en effet tendance à oublier sa dimension jeu, à positionner ses joueurs et ses joueuses dans la passivité.
ROBOCOP : ROGUE CITY (2023)
★★☆☆☆
![]()
 Écraser l’accélérateur, brûler l’asphalte, froisser la tôle, tout en étant bercé par la verve de l’iconique – et agaçante – DJ Diabolika… Il y a de ces programmes qui ne vieillissent pas, et celui de Burnout Paradise en fait indéniablement parti. Les années passent, et il se destine encore à incarner ce rendez-vous régulier. En 2008, pourtant, je n’aurais jamais parié dessus : la production m’avait autant impressionnée, avec son sens aigu de la mise en scène, du carambolage, que désenchantée. Troquer le format classique d’un jeu de course contre la structure d’un open-world empêche le soft d’exceller, d’être à la hauteur de ses aînés, 2 et Takedown (Revenge n’existe pas). Avec Burnout Paradise, la dimension course passe à la trappe : il n’arrive jamais à la rendre intéressante, la faute à des tracés sans variété – refaire encore et toujours ces mêmes lignes droites – et à une I.A. peu concurrentielle. Mais le plaisir est ailleurs : passer au travers de ces panneaux, exploser ces barrières, terrasser ces adversaires, trouver ces super-sauts… Si l’open-world est sa faiblesse, il est aussi sa force, un monde que l’on parcourt avec passion en long, en large et en travers pour y déloger tous ses secrets. Un épisode à part, particulier, mais que j’aime relancer tous les cinq ans pour remplir cette même quête : celle du 100%.
Écraser l’accélérateur, brûler l’asphalte, froisser la tôle, tout en étant bercé par la verve de l’iconique – et agaçante – DJ Diabolika… Il y a de ces programmes qui ne vieillissent pas, et celui de Burnout Paradise en fait indéniablement parti. Les années passent, et il se destine encore à incarner ce rendez-vous régulier. En 2008, pourtant, je n’aurais jamais parié dessus : la production m’avait autant impressionnée, avec son sens aigu de la mise en scène, du carambolage, que désenchantée. Troquer le format classique d’un jeu de course contre la structure d’un open-world empêche le soft d’exceller, d’être à la hauteur de ses aînés, 2 et Takedown (Revenge n’existe pas). Avec Burnout Paradise, la dimension course passe à la trappe : il n’arrive jamais à la rendre intéressante, la faute à des tracés sans variété – refaire encore et toujours ces mêmes lignes droites – et à une I.A. peu concurrentielle. Mais le plaisir est ailleurs : passer au travers de ces panneaux, exploser ces barrières, terrasser ces adversaires, trouver ces super-sauts… Si l’open-world est sa faiblesse, il est aussi sa force, un monde que l’on parcourt avec passion en long, en large et en travers pour y déloger tous ses secrets. Un épisode à part, particulier, mais que j’aime relancer tous les cinq ans pour remplir cette même quête : celle du 100%.
BURNOUT PARADISE (2008)
★★★☆☆
![]()
 Beat’em up ? Pas vraiment. RPG ? Non plus. TMNT : Mutant Unleashed ne sait pas sur quel pied danser et vise pile au milieu d’un entre-deux genres. En résulte alors une vision barbare qui distille ici et là des éléments venant de mondes (trop ?) différents, des mécaniques tout juste effleurées. En premier lieu, ces séquences de combats bien trop courtes, bien trop rares, et surtout bien trop approximatives. Elles donnent l’impression de frapper dans le vide, de se protéger sans que les animations l’indiquent vraiment – de subir plutôt que de jouer. Et pourtant, on y ressort victorieux, toujours. Dans un second temps, il y a ces nombreux dialogues qui habillent l’aventure, la dynamitent également, la morcellent. Pour AHEARTFULOFGAMES, le jeu de rôle ne se résume qu’à ça, des discussions en pagaille, qui ne racontent étonnamment rien. Elles font office de remplissage pour que les fans en aient pour leur argent. En ligne droite, séquences de plates-formes et d’affrontements comprises, Mutant Unleashed dure cinq bonnes heures. Si l’on souhaite au contraire profiter de tout ce que le soft a à « offrir » – dialogues, allers-retours incessants, cut-scenes inutiles (et chargements multiples) – il dépasse aisément les vingt heures. Heureusement, noyées parmi les innombrables lignes de textes, des thématiques plus fortes sortent la tête de l’eau : celles du racisme, de l’acceptation de soi et de l’autre – des sujets directement tirés du film Mutant Mayhem infiniment plus intéressant.
Beat’em up ? Pas vraiment. RPG ? Non plus. TMNT : Mutant Unleashed ne sait pas sur quel pied danser et vise pile au milieu d’un entre-deux genres. En résulte alors une vision barbare qui distille ici et là des éléments venant de mondes (trop ?) différents, des mécaniques tout juste effleurées. En premier lieu, ces séquences de combats bien trop courtes, bien trop rares, et surtout bien trop approximatives. Elles donnent l’impression de frapper dans le vide, de se protéger sans que les animations l’indiquent vraiment – de subir plutôt que de jouer. Et pourtant, on y ressort victorieux, toujours. Dans un second temps, il y a ces nombreux dialogues qui habillent l’aventure, la dynamitent également, la morcellent. Pour AHEARTFULOFGAMES, le jeu de rôle ne se résume qu’à ça, des discussions en pagaille, qui ne racontent étonnamment rien. Elles font office de remplissage pour que les fans en aient pour leur argent. En ligne droite, séquences de plates-formes et d’affrontements comprises, Mutant Unleashed dure cinq bonnes heures. Si l’on souhaite au contraire profiter de tout ce que le soft a à « offrir » – dialogues, allers-retours incessants, cut-scenes inutiles (et chargements multiples) – il dépasse aisément les vingt heures. Heureusement, noyées parmi les innombrables lignes de textes, des thématiques plus fortes sortent la tête de l’eau : celles du racisme, de l’acceptation de soi et de l’autre – des sujets directement tirés du film Mutant Mayhem infiniment plus intéressant.




Laisser un commentaire